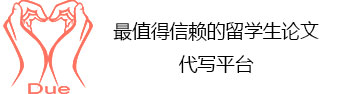服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈La_Co-Création_Des_Conventions
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
3èmes Journées de doctorants FROG 2002 Université Paris-Dauphine les 3 et 4 octobre 2002
COMMUNICATION
LA COCONSTRUCTION DES CONVENTIONS COMME MODE DE COORDINATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION : LE CAS DE LA CONVENTION D’APPROPRIATION.
Mots clés : coordination intra-organisationnelle – Conventions - construction des conventions – appropriation – secteur bancaire
Loïc Plé Allocataire de recherche CREPA Université Paris IX-Dauphine
Contact : lple@club-internet.fr Adresse postale : 142 Allée de Liège Rés. Cristal, Appt 371 59777 Euralille
1 Il est désormais admis que le formidable développement des technologies de l’information et des communications (TIC) a profondément affecté l’ensemble des activités de la chaîne de valeur. Parmi celles-ci, il en est une, qui retient toute notre attention : la distribution. En effet, ces TIC ont engendré une multiplication des canaux de distribution, au sens de “technologie de vente au détail”, d’“interface entre le distributeur et le consommateur” (Filser, 1989 : 151). In fine, cela se traduit par un accroissement des contacts potentiels entre l’entreprise et ses clients, puisqu’aux traditionnels points de vente physiques (le “réel”, ou mortar), se sont ajoutés des canaux “à distance” : centres d’appels téléphoniques de plus en plus perfectionnés, sites Internet, télévision interactive... (Le “virtuel”, ou click). D’aucuns avaient d’abord prédit la mort des premiers au bénéfice des seconds. Pourtant, des relations de complémentarité, non de substitution, semblent progressivement s’instaurer entre ces canaux (Gulati et Garino, 2000). Il n’en reste pas moins que de la mise en place d’une telle stratégie, que nous qualifions d’intégrée ( basée sur ces deux types de canaux) et d’une telle organisation émergent de multiples interrogations dont la plus fondamentale, selon nous, touche à la gestion des inévitables interdépendances entre ces interfaces. Ce faisant s’invite la problématique de la coordination entre ces canaux de distribution. En effet, une définition largement admise de la coordination est “la gestion des dépendances entre des activités” (Malone et Crowston, 1994 ; Crowston, 1997), qui surviennent “lorsque les actions entreprises par un système référent affectent les actions ou les résultats des actions d’un autre système” (Mc Cann et Ferry, 1979 : 113). Le tout est alors de savoir quels mécanismes de coordination permettront de gérer ces interdépendances. Ceci est d’autant plus crucial dans les entreprises de services, pour au moins deux raisons. Tout d’abord, les caractéristiques des services - intangibilité, inséparabilité, hétérogénéité et périssabilité (Eiglier et Langeard, 1987) – ont déjà amené plusieurs entreprises à développer des stratégies de distribution intégrées : banques, assurances, voyagistes… en sont autant d’illustrations. Ensuite, le processus de servuction (processus de création du service, au sens d’Eiglier et Langeard, 1987) se démarque du processus de production traditionnel par une participation plus ou moins active du client. Or, les mécanismes de coordination connus ne tiennent en général pas compte de cette participation du client, c’est à dire de la participation d’un élément externe à l’entreprise.
2 Ainsi, il semblerait que la littérature ne recèle ni d’études offrant une perspective que l’on pourrait caractériser de contingente de la coordination intra-organisationnelle, ni de travaux portant sur la coordination des canaux de distribution au sens de formules de ventes1. Pour contourner ce problème, nous proposons une lecture de ces canaux de distribution à travers la théorie des conventions : “dispositif cognitif collectif” (Favereau, 1989 : 295), la convention est un “mode de coordination collective” (de Montmorillon, 1999 : 172), un “référentiel commun”, “coconstruction de normes et de comportements” (Gomez, 1996 : 175). Nous l’appliquons au cas de la banque de détail (distribution de produits et services bancaires et financiers aux particuliers), où une étude empirique nous a d’ores et déjà permis d’identifier un type particulier de convention : l’appropriation, qui concerne essentiellement les conseillers travaillant en agence, et qui paraît jouer un rôle majeur dans la coordination entre les canaux. Il s’agit pour les conseillers du réseau d’agences, autrefois seuls maîtres de la relation avec le client, et intermédiaires uniques entre celui-ci et la banque, d’accepter l’existence de ces canaux, et de les promouvoir auprès des clients. Après un rapide rappel sur la théorie des conventions, nous montrerons pourquoi nous pensons pouvoir effectivement parler de convention d’appropriation dans le cas que nous étudions. Puis nous nous attacherons à proposer un modèle de genèse de cette convention basé sur la notion d’encastrement développée par Mark Granovetter (20002). En procédant de la sorte, nous cherchons à montrer le rôle joué par le client, et par l’appartenance du conseiller à différents réseaux sociaux (Degenne et Forsé, 1994) sur la construction de la convention d’appropriation en tant qu’un des modes de coordination des canaux de distribution.
Nous précisons la signification du terme canal dans ce cas particulier, car la littérature retient principalement cette appellation pour désigner les « ensembles d’organisations interdépendantes impliquées dans le processus de mise à disposition d’un produit ou d’un service pour la consommation ou l’usage” (Stern, El-Ansary & Coughlan, 1996 : 1). Cette appellation renvoie à une chaîne allant du producteur du bien au consommateur final, en passant par différents intermédiaires. Les travaux sur la coordination dans le canal ont été menés respectivement à cette vision : c’est donc la coordination inter-, et non intra-, entreprises qui est étudiée. 2 Il s’agit là de la version française de l’article de 1985, parue dans l’ouvrage Le Marché autrement, essais de Mark Granovetter.
1
3
I. DE LA NOTION DE CONVENTION.
Notre objectif n’est pas ici de nous livrer à une revue de la littérature relevant de la théorie des Conventions. Le lecteur trouvera d’excellentes synthèses par ailleurs (par exemple : Gomez, 1994 ; de Montmorillon, 1999 ; Batifoulier et de Larquier, 2001). Nous revenons surtout ici sur la notion de convention afin d’en préciser les contours. Puis nous nous penchons ensuite sur les modes d’existence et l’axiomatique des conventions, en nous appuyant majoritairement sur Gomez (1994 ; 1997 ; 1998).
A. QUELQUES DEFINITIONS.
C’est avec le sens commun de la convention que nous jugeons nécessaire d’introduire cette section. Ceci nous permettra de souligner à la fois un paradoxe frappant, auquel il n’est semble-t-il jamais fait référence dans la littérature, et de poser les bases des définitions que l’on trouve dans ladite littérature. 1. Du sens commun de la convention. Au mot convention correspondent les définitions suivantes3 : « I. 1. Accord, pacte, contrat entre deux ou plusieurs personnes (physiques, morales, publiques). Conventions collectives: accord conclu entre des représentants des salariés et des représentants des employeurs pour régler les conditions de travail. / Stipulation particulière, clause que contient un traité, un pacte ou un contrat. 2. Ce qu’il convient d’admettre. Les conventions sociales ou, les conventions. Ce que l’on est tacitement convenu d’admettre. Les conventions du théâtre. 3. De convention : qui n’a de valeur, de sens, que par l’effet d’une convention. Signe de convention. - Péjoratif : Qui ne résulte que de l’usage établi par les conventions sociales. Un sourire, des amabilités de convention. II. 1. HIST Assemblée nationale munie de pouvoirs extraordinaires, soit pour établir une constitution, soit pour la modifier. 2. Aux États-Unis, congrès d’un parti réuni pour désigner un candidat à la présidence. »
3
Dictionnaire encyclopédique Hachette Multimédia, Edition 1999.
4 Passons sur les deux dernières significations4, dont les origines sont historiques, pour nous attarder sur les trois premières. Le lecteur conviendra alors avec nous de l’opposition patente entre la première définition, et les deux suivantes : la convention peut autant être un contrat, qu’un accord tacite résultant d’un ordre établi. Or, contrats5 et conventions (au sens d’accord tacite) renvoient à des logiques différentes, a priori diamétralement opposées dans leur conception et leur élaboration. A priori, car si l’on suit Durkheim, pour qui « le contrat ne se suffit pas à soi-même » (Durkheim, 1978 : 193), et « si l’on admet que même les relations contractuelles exigent le présupposé d’un cadre commun constitutif, [lequel] est alors envisagé non comme le résultat d’un contrat primitif ainsi que le supposent les théories contractualistes, mais plutôt comme une théorie, un paradigme (Orléan), un modèle cognitif (Favereau), un système de connaissances (Salais), des représentations, une structure d’information, etc… qui construisent les informations jugées pertinentes et utiles pour l’action et déterminent la nature des objets qui peuvent servir de ressources » (Revue Economique, Introduction collective, 1989), alors on peut analyser ces deux concepts à l’aune de leur complémentarité respective. C’est d’ailleurs là un des objectifs de cette approche, que de montrer que les conventions complètent utilement d’autres théories permettant d’expliquer la coordination entre des acteurs individuels dans le cadre d’une action collective. Objectif dont nous jugions utile de souligner qu’il est originellement sous-jacent dans la définition même de la convention, à laquelle il n’est en général fait référence que partiellement dans la littérature, puisque d’ordinaire, seule en est rappelée la dimension tacite (par exemples, de Montmorillon, op.cit ; Salais, 1989 : 227 ; Batifoulier et de Larquier, 2001a : 10). 2. De la convention dans la littérature. Si l’on s’en tient à la présentation de Gomez (1994 : 78), il existe deux approches du concept de convention : « à l’américaine » et « à la française ». Cette dernière, dont l’acte fondateur réside en la publication du numéro spécial de la Revue Economique en 19896 , retiendra l’essentiel de nos réflexions à partir de maintenant7. Toutefois, asséner une suite de
4
Pour un lien entre la théorie des Conventions et la première de ces significations historiques, voir de Montmorillon, 1999 : 173-174. 5 Au sens de l’approche néo-institutionnelle (Williamson, 1975, 1985) 6 Bien qu’il ne faille pas négliger les travaux réalisés entre 1984 et 1989, Orléan proposant pour sa part comme date de création de cette communauté de recherche la table Ronde INSEE-CNRS des 22 et 23 novembre 1984 (Orléan, 1994 : 13). 7 A l’exception notable des travaux de Lewis (1969) que nous reprendrons (section 1.2) du fait de leur impact sur cette école française.
5 définitions sous forme purement narrative, nous paraissant d’une utilité limitée et fastidieux pour le lecteur (lequel ne peut identifier rapidement les différences et similitudes), nous avons préféré comme format de présentation, le tableau ci-après. Celui-ci ne se veut bien évidemment pas exhaustif, la multiplication de recherches liées à la théorie des conventions rendant une telle tentative quasiment impossible. TABLEAU 18 : Quelques définitions de la convention dans la littérature francophone AUTEUR DEFINITION
Introduction collective, « Dispositif constituant un accord de volontés […] doté d’une force Revue Economique, n°2, normative obligatoire, la convention doit être appréhendée à la fois mars 1989 : 143 comme le résultat d’actions individuelles et comme un cadre contraignant les sujets » Orléan, 1989 : 265-267 (à « Elle désigne l’organisation sociale au travers de laquelle la propos de la convention communauté se dote d’une référence commune, produit d’une imagination collective extériorisée qui fonde les anticipations financière9) individuelles. [Sa caractéristique est] d’agir sur les interprétations des agents. Elle s’identifie à une représentation collective qui délimité a priori le champ des possibles. […] Il s’agit d’un dispositif cognitif qui tend à faire prévaloir les attitudes « confirmationnistes » ». En résumé, « La convention consiste en un « dispositif cognitif collectif »reposant sur un principe d’économie des ressources cognitives, au sens où on ne cherche à produire de nouvelles connaissances que dans la mesure où ont été épuisées toutes les tentatives d’interprétations compatibles avec l’état antérieur du savoir ». Favereau, 1989 : 29510 Orléan, 1994 : 15-16 « Dispositif cognitif collectif ». « Permettant d’aborder la question générale de la coordination collective des actions individuelles, [le concept de convention a pour ambition de] comprendre comment se constitue une logique collective et quelles ressource elle doit mobiliser pour se stabiliser ».
Gomez, 1994 : 129 (parmi « Structure de coordination des comportements offrant une procédure les nombreuses définitions de résolution récurrente de problèmes. Elle délivre un énoncé, proposées) information sur les comportements identiques des adopteurs, et se réalise dans un dispositif matériel de telle manière que l’interprétation de cette information demeure compatible avec le maintien de la procédure collective. Elle compose une structure dynamique qui évolue sous l’influence de suspicions de convention face auxquelles elle peut résister, s’effondrer ou se déplacer ».
Les recherches sus-citées ont été essentiellement menées en économie, domaine dans lequel les recherches sur le sujet semblent relativement plus nombreuses qu’en Sciences de Gestion (Batifoulier et de Larquier, 2001 : 16). 9 Nous touchons à un type particulier de convention, tandis que les autres définitions concernent les conventions selon une signification générique. Nous verrons plus loin qu’existent de multiples conventions particulières. 10 Nous avons intégré la définition donnée par Favereau en nous faisant ainsi l’écho de nombreuses autres présentations (de Montmorillon, 1999 : 171 ; Orléan, 1994). Toutefois, remarquons que, plus exactement, l’auteur définit les règles par cette expression.
8
6
Ramaux, 1996 : 130
« Cadre d’interprétation et de référence collectif que l’on accepte comme un cadre commun, dans la mesure où il est perçu comme allant de soi et, pour aller de soi, il n’est pas le produit direct d’une volonté d’une (ou de plusieurs) personne (s) engagées dans l’action ». « Référentiel commun sans autre raison d’être que celle-ci : elle est adoptée comme référentiel ». Il y a « coconstruction de normes et de comportements ». « Systèmes de règles auxquelles les individus font référence lorsqu’ils justifient leurs comportements ».
« Référentiel commun, coconstruction de normes et de comportements »
Gomez, 1996 : 175
Gomez, 1997 : 1062
De Montmorillon 11 , 1999 : 181
Batifoulier et de Larquier, « Règle particulière 2001a : 13 caractéristiques.
de
comportement,
[elle]
présente
trois
L’arbitraire. La convention est arbitraire au sens où il existe d’autres possibilités pour se coordonner. Le fait de ne pas avoir conscience d’adopter une solution particulière suspend l’explicitation des raisons d’agir quand la coordination est réussie. Le vague de la définition. Même si l’on peut parfois en donner une énonciation explicite, il n’existe pas de formulation officielle, ou consacrée, de la convention. La connaissance éventuelle de son histoire est sans effet sur son application. L’absence de menaces explicites de sanctions. La convention n’a pas besoin d’être soutenue par des menaces explicites de sanctions en cas de non-respect, mais l’existence d’une menace implicite de sanctions est envisageable ».
Un commentaire rapide de ce tableau s’impose. Tout d’abord, même si l’on suivra Batifoulier (2001), Batifoulier et de Larquier (2001a) et Gomez (1997 ; 1998) pour convenir de la polysémie du terme de convention, et des difficultés à fonder véritablement une théorie des conventions, il convient de relever la convergence entre les éléments de plusieurs de ces définitions. L’objectif d’une convention est ainsi d’assurer la coordination entre des acteurs individuels dans le cadre d’une action menée collectivement. N’ayant pas de support écrit, elle se rapproche plus d’un accord tacite entre ces individus, comme l’illustre parfaitement la notion de « dispositif cognitif collectif », ou plus rigoureusement d’une norme de comportement à laquelle les individus vont se référer lorsqu’ils seront en situation d’incertitude. Mais nous touchons là aux modes d’existence, et plus encore à l’axiomatique des conventions, qui sont l’objet de notre seconde section.
11
Adopte explicitement la définition fournie par Gomez, 1996.
7
B. CONDITIONS D’EXISTENCE ET AXIOMATIQUE DES CONVENTIONS.
Comme son nom l’indique, cette partie vise à poser les conditions d’existence et l’axiomatique des conventions, avec pour visée de compléter les définitions précédentes. Ainsi aurons-nous précisé, à la fin de cette première partie, ce que nous entendons par convention, et pourrons-nous y renvoyer lorsque nous aurons à montrer que l’appropriation (cf. seconde partie) est une convention, dont nous proposerons un modèle de genèse. 1. Conditions d’existence d’une convention12. Sur les trois recherches sur lesquelles nous nous appuyons, il nous semble que Gomez identifie cinq propriétés conditionnant l’existence des conventions. L’incertitude : bien que considérant les choix d’individus autonomes comme points de départ de l’analyse économique, suivant ainsi le principe fondamental de l’individualisme méthodologique, la théorie des conventions s’intéresse aux situations d’incertitude radicale, au sens de Knight, 1921. Les calculs individuels ne sont donc pas en mesure de résoudre ces situations, en face desquelles il faut opposer de nouvelles solutions. Le mimétisme rationnel : de Montmorillon montre qu’il s’agit là en fait d’une rationalité particulière, qu’il qualifie de « mimétique » (de Montmorillon, 1999 : 183). Puisque l’on se trouve dans une situation d’incertitude, « le choix rationnel de l’individu consiste non pas à décider selon des critères correspondant à son propre goût, mais à découvrir comment les autres vont vraisemblablement décider » (Gomez, 1997 : 1063). Il y a donc une recherche de la référence normative de comportement, sur laquelle chacun va baser son propre comportement, débouchant sur une auto-réalisation de l’état du monde anticipé par les acteurs (Orléan, 1989). Ce faisant, les acteurs n’ont nul besoin de se justifier en permanence de leurs choix (Boltansky et Thévenot, 1991 ; Gomez, 1998 :4). La stabilité (de la convention) : une convention est une régularité, qui « s’impose de manière récurrente et systématique pour régler un problème d’incertitude donné » (Gomez, 1997 : 1064). Ce n’est donc pas une solution
Cette partie effectue la synthèse de Gomez, 1994 ; 1997 ; 1998. Nous sommes conscients des limites qui peuvent être formulées à l’encontre de ces travaux. Cependant, cette discussion n’étant pas le cœur de la présente recherche, nous renvoyons le lecteur à la synthèse critique particulièrement stimulante de Romelaer, 1999.
12
8 ponctuelle, ne s’appliquant qu’à un événement unique et qui ne sera plus utilisée par les acteurs une fois passée la situation d’incertitude. La conviction des individus : cette propriété est intimement reliée au mimétisme rationnel. « La convention cristallise les comportements d’imitation de façon telle que chaque individu croit en l’existence de la convention comme règle « normale », en dehors de sa propre adhésion » (Gomez, 1997 : 1064). En d’autres termes, « la convention donne du sens aux calculs individuels qui s’y inscrivent » (Gomez, 1994 : 92). La non-nécessité conventionnelle : l’individu a le choix d’adopter ou non la convention, qui ne s’imposera in fine à lui qu’en raison des performances (supposées, espérées, attendues) de la convention. Ces cinq facteurs sont une explication générale de la nature de la convention et du contexte dans lequel on peut parler de convention. Ils sont une introduction à l’axiomatique conventionnaliste. 2. L’axiomatique conventionnaliste. Cette axiomatique a en fait été développée par Lewis13 (1969), mais est utilisée par de nombreux auteurs de la théorie des conventions14 (Gomez, 1994, 1997 ; Orléan, 1994 ; Dupuy, 1989…). Nous en retiendrons la présentation d’Orléan (1994 : 23), qui suit : « Une convention est une régularité R dans le comportement des membres d’une population P, placés dans une situation récurrente S [d’incertitude, posant des problèmes de coordination15], si les six conditions suivantes sont satisfaites : (C1) Chacun se conforme à R. (C2) Chacun croit que les autres se conforment à R. (C3) Cette croyance que les autres se conforment à R donne à chacun une bonne et décisive raison de se conformer lui-même à R. (C4) Chacun préfère une conformité générale à R, plutôt qu’une conformité légèrement moindre que générale.
Pour une synthèse des critiques des travaux de Lewis, voir Urrutiaguer, Batifoulier et Merchiers, 2001. A cette différence près entre les auteurs cités que Gomez identifie 5 conditions chez Lewis, tandis qu’Orléan et Lewis en repèrent 6. 15 Nous rajoutons ces notions d’incertitude et de besoin de coordination, car elles justifient le recours à la convention.
14 13
9 (C5) R n’est pas la seule régularité possible satisfaisant les deux dernières conditions. (C6) Les conditions précédentes (1 à 5) sont connaissance commune16 ». Si l’on suit Batifoulier et de Larquier (2001a), dans cette perspective, il n’est pas fait état de sanction en cas de non-respect de la convention, si ce n’est « l’échec de la coordination » ( : 17). Selon eux, l’intégration de la notion de sanction ne répond plus à la même logique conventionnelle, et renvoie à une analyse plus proche de Weber, qui parle non de sanctions juridiques reposant sur un appareil coercitif, mais d’un « boycott social » (sans préciser les dimensions que peuvent prendre ce boycott). Néanmoins, nous ne sommes pas entièrement convaincus par leur argumentation. Ils se rapportent à Hume, dont ils reprennent l’exemple des deux rameurs : ceux-ci se coordonnent entre eux par « un accord spontané entre individus sur le respect d’un corpus de « règles » consacré par l’expérience et l’habitude » (Batifoulier et de Larquier, op.cit. : 18).Cet accord spontané va permettre d’assurer la compatibilité entre intérêt individuel et intérêt collectif. Et la seule sanction serait « l’échec de la coordination ». Certes, dans un premier temps, ce peut être l’unique sanction. Mais qui garantit que le rameur n’ayant pas respecté la convention ne se verra pas exclu de l’équipe ' Ou ne se verra plus accorder la confiance de ses supporters ' Le boycott social que l’on retrouve chez Weber fait alors son apparition dans ce cas, introduisant la potentialité de la sanction dans le modèle de Lewis.
L’objectif de cette première partie était de familiariser le lecteur avec la notion de convention. Nous avons vu ce qu’était une convention, de même que les axiomes qui permettent de se réclamer de ce mouvement. Dès lors, nous nous trouvons en possession des éléments théoriques nécessaires pour nous livrer à notre analyse empirique, au cours de laquelle nous allons tenter de démontrer que ce nous étudions est effectivement une convention.
16
Sur la connaissance commune, voir Dupuy, 1989.
10
II. LA CONVENTION D’APPROPRIATION DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION BANCAIRES17.
Présentation du terrain ayant servi à l’analyse empirique, et introduction de la convention d’appropriation sont les deux clés de cette seconde partie.
A. LE TERRAIN RETENU.
Avant de présenter l’entreprise au sein de laquelle nous avons recueilli nos données, et les modalités dudit recueil, nous allons faire un point sur les bouleversements qui affectent les stratégies distributives des établissements bancaires français depuis les cinq dernières années. 1. La révolution distributive de la banque de détail. Depuis une vingtaine d’années, le secteur de la banque de détail est touché de plein fouet par la métamorphose totale de son environnement : les évolutions réglementaires, couplées à des innovations technologiques sans précédents dont découlent des capacités de traitement et de communication accrues, ont ouvert les portes à de nouveaux concurrents, tant bancaires que non bancaires, nationaux ou internationaux. Dans le même temps, les clients de ces établissements sont devenus plus compétents, plus à même d’apprécier l’offre de services, et de fait plus exigeants18. Une des conséquences majeures de ces transformations, particulièrement patente depuis quatre ou cinq ans, est l’émergence de nouveaux canaux de distribution, qui sont autant de vecteurs de communication et de vente leur permettant de rentrer en contact avec leurs clients (figure 1) : agences physiques, distributeurs et guichets automatiques (DABGAB), serveur Minitel, service audiotel (service téléphonique automatisé, disponible 24h/24 permettant de réaliser quelques transactions courantes telles que la consultation des comptes, la réalisation de virements, la demande de chéquiers,…), plates-formes téléphoniques émettrices ou réceptrices d’appels (permettant d’alléger la charge de travail des agences pour des tâches à faible valeur ajoutée, leur laissant plus de temps pour assurer leurs missions de conseil et de vente), sites Internet (institutionnel, qui informe sur l’établissement ; transactionnel, qui permet de réaliser la majorité des opérations courantes, à faible valeur ajoutée ; et relationnel, plus orienté vers la dimension de conseil), télévision interactive (le
17
Nous traitons exclusivement de la banque de détail des particuliers, c'est-à-dire la distribution des produits et services bancaires et financiers au client individuel. 18 Nous avons exposé l’ensemble de ces transformations dans un travail préliminaire de DEA.
11 Crédit Agricole ou les Caisses d’Epargne, en partenariat avec TPS), services WAP et, à terme, UMTS (disponibles sur téléphone mobile).
FIGURE 1 : la multiplication des canaux de distribution bancaires.
Plates-formes téléphoniques Distributeurs et Guichets Automatiques Serveur audiotel
D ISTRIBUTION DE
Internet
PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES
Minitel
Télévision interactive Agences physiques
Services sur mobiles
Si, dans un premier temps, d’aucuns ont prédit la mort des canaux traditionnels (les agences), et leur remplacement par les canaux “à distance”, il semblerait que, finalement, s’instaurent progressivement des relations de complémentarité, et non de pure substitution, entre ces canaux (Gulati & Garino, 2000). Ceci est d’autant plus vrai en France, où les banques ne croient guère en la disparition des agences au profit d’une relation déshumanisée, même s’il est vrai que les clients désertent de plus en plus leur agence. Si des fermetures sont programmées, elles n’interviennent que dans le cadre de restructurations géographiques du réseau, par le biais de techniques de géomarketing, visant à accroître la rentabilité. Par ailleurs, nous identifions au moins trois différences de fond entre les cultures latine et anglo-saxonne, qui permettent de laisser présager du bien-fondé du développement de cette organisation mixte en France : 1. Les Français ressentent le besoin d’un écrit pour confirmer chaque transaction, qu’ils tiennent comme une preuve ; 2. La qualité de service est supérieure dans les agences françaises (surtout par rapport aux agences britanniques), et les clients en sont très satisfaits ;
12 3. Ces deux premières différences font que les services à distance se sont plus vite développés Outre-Manche et aux Etats-Unis, entrant dans les mœurs de consommation courante. Il n’en reste pas moins que la mise en place d’une stratégie distributive que nous qualifions d’intégrée (basée sur ces deux catégories de canaux, encore appelée « clicks and mortars » ou « bricks and clicks ») entraîne de multiples interrogations, telles que : des conflits sont-ils susceptibles d’apparaître entre les canaux ' Y-a-t-il vraiment complémentarité, ou substitution ' Quels avantages les clients de l’entreprise retirent-ils de la mise en place de ces nouveaux vecteurs distributifs ' En résumé, comment assurer la coordination entre ces différents canaux ' Au cœur de ces questions : le réseau d’agences. Point de contact historique entre la banque et ses clients, l’agence demeure le lieu privilégié des contacts à forte valeur ajoutée, créateurs de valeur pour la banque. Elle reste donc la pierre angulaire de la stratégie des acteurs bancaires traditionnels19, mais dans un contexte nouveau pour les conseillers qui y travaillent : il s’agit pour eux d’accepter l’existence de ces canaux, et de les promouvoir auprès des clients, tandis qu’ils étaient autrefois seuls maîtres de la relation avec ces derniers, et intermédiaires uniques entre ceux-ci et la banque. Tout ceci illustre bien des problématiques de coordination auxquelles doivent répondre les banques, en mettant en particulier l’accent sur la gestion des agences et des conseillers. Avec en plus, le paradoxe suivant : ces nouveaux canaux sont généralement proposés dans des packages, ou conventions de services ou de comptes20, qui sont vendus aux clients comme étant des services. Et cette vente est de fait assurée par… les conseillers des agences ! 2. Terrain et méthodologie. Nous avons pour l’instant mené notre travail empirique suivant deux phases distinctes, et séparées de quelques mois par un retour sur la littérature. Nous attirons au passage l’attention du lecteur sur quelques éléments concernant cette recherche :
19
Pas uniquement de ces acteurs d’ailleurs. On peut citer les exemples de nouveaux entrants online qui ont décidé d’ouvrir des points de vente physiques, tels que ING Direct, Consors, ou Ze Bank qui par le biais d’un partenariat avec une grande surface, a affiché sa volonté de rompre, au moins partiellement, avec son modèle strictement online. 20 Nous reprenons ici l’expression consacrée parmi les professionnels du secteur bancaire, sans qu’il n’y ait a priori de liens directs avec nos développements antérieurs ou futurs. Encore qu’il serait intéressant de s’interroger sur les origines de cette expression. Après tout, Gadrey parle de convention de service.
13 Elle porte d’une façon plus générale que nous l’abordons ici sur les mécanismes de coordination des canaux de distribution bancaires. Au cours de notre travail de terrain a émergé la notion de convention, dont nous avons considéré qu’elle permettait d’apporter des réponses partielles à nos interrogations en termes de coordination. Enfin, durant la première phase de l’analyse de nos données qualitatives, nous avons décelé la possibilité de proposer, sur la base de nos résultats partiels, un modèle de genèse de la convention, exposé dans la dernière partie de ce document. La première étape de ce travail empirique a consisté en la réalisation de cinq entretiens semi-directifs centrés avec des responsables fonctionnels de différentes banques (un directeur régional, deux responsables marketing, un directeur des études et du développement rencontré à deux reprises). L’objectif de ces entretiens exploratoires était double : Approfondir notre connaissance du secteur bancaire en recueillant les opinions de spécialistes au contact de la réalité quotidienne du terrain. Valider l’intérêt des premières hypothèses de recherche issues d’une revue préalable de la littérature. De ces premiers entretiens exploratoires, intégralement retranscrits, nous avons pu infirmé et confirmé certaines de nos intuitions, et dégagé des pistes de recherche nouvelles en termes de coordination des canaux de distribution, parmi lesquelles, en particulier, l’appropriation, sur laquelle nous nous pencherons ensuite. Après un retour sur la littérature, nous sommes avons débuté une première étude de cas. Elle s’est déroulée au sein d’une banque régionale du Nord de la France. Cet établissement peut être qualifié de « suiveur » en ce qui concerne sa stratégie dans les nouveaux canaux de distribution, dans la mesure où ceux-ci ont commencé à être mis en place plus tardivement que la majorité de ses concurrents. Ainsi, une plate-forme sortante (émettrice d’appels, destinée au démarchage des clients) a-t-elle été mise en place mi-1998. Selon une cassette de l’époque destinée à la communication interne, les réactions des conseillers vis-àvis de cette plate-forme furent particulièrement négatives. Une autre plate-forme, entrante cette fois (réceptrice d’appels émis par les clients) a été lancée deux ans plus tard (mi-2000). Quant au site Internet, il existe depuis quatre ans environ, mais est longtemps resté peu utilisé par les clients (la politique de communication de la banque à l’époque n’aidait pas à son
14 développement). Enfin, une offre via la télévision interactive est aussi présente sur le bouquet Canalsatellite, mais son taux d’utilisation est si faible que nous ne la prendrons pas en compte dans notre réflexion ultérieure. Ainsi, pour récapituler, lorsque nous parlerons plus tard de nouveaux canaux de distribution, cela renverra au cas de cette banque régionale, qui a à sa disposition : les services audiotel21 ; les plates-formes téléphoniques (entrantes et sortantes) ; le minitel ; le site Internet. Nous avons réalisé notre étude de cas entre juin et décembre 2001, suivie d’un « débriefing » des résultats avec le directeur de région tout d’abord, puis la responsable marketing en mars 2002 22 . Par ailleurs, dans le cadre de notre DEA, nous avions déjà rencontré le directeur de région au début de l’année 1999, et l’avions revu en octobre 2000 pour prendre un premier contact et lui présenter nos directions de recherche doctorale. Nous nous étions alors longuement entretenus sur les développements des deux plates-formes (dont la seconde venait d’être créée, et que nous avons visitée) et leurs implications organisationnelles et stratégiques. L’étude de cas en elle-même s’est déroulée selon les modalités suivantes : Entretiens semi-directifs centrés : les populations visées au sein de la banque étaient différentes. Du fait de notre thème de recherche (la coordination des canaux de distribution bancaires), nous avons rencontré : le directeur de région (à deux reprises) ; 15 personnes travaillant dans 4 agences différentes (11 conseillers clientèle et 4 directeurs d’agence) ; 6 conseillers travaillant sur les plates-formes téléphoniques (3 sur chaque plate-forme) ; la responsable des plates-formes ; le directeur marketing. Soit un total de 25 entretiens semidirectifs, tous intégralement retranscrits, et dont l’analyse de contenu est en cours de finition. Chaque entretien a fait l’objet d’un résumé adressé aux personnes interviewées pour validation de leurs propos. Recueils et analyses de documents internes : nous avons eu accès à des documents de communication interne (vidéo et supports écrits) élaborés pour la mise en place des plates-formes téléphoniques. Ce sont en effet surtout ces plates-formes, du fait de leur composante humaine, qui semblaient représenter « un danger » pour les agences. Les questions et interrogations des conseillers
21
Nous aurions pu les rapprocher des plates-formes téléphoniques, mais ils s’en distinguent de par la nature exclusivement technologique du support de délivrance du service. 22 Du fait de la mise en place de l’euro, nous avons préféré attendre une période plus calme pour présenter ces résultats et les discuter avec ces responsables.
15 posées dans la vidéo de l’introduction de la plate-forme sortante (la première) en étaient une illustration frappante. Quant aux réponses apportées par la direction dans ladite cassette, elles visaient à essayer de les rassurer : « la plateforme ne remplacera pas l’agence », « la plate-forme est le complément des agences, elle vient en support des agences ». De ces entretiens et des documents que nous avons eus à notre disposition, nous avons pu identifier une modalité particulière de la gestion des canaux de distribution : l’appropriation. Notre prochaine section va s’attacher à détailler ce que l’on entend par cette notion, tant dans la littérature que dans notre cas particulier, puis nous montrerons en quoi l’on peut parler, plus exactement, de convention d’appropriation. Nous en proposerons un modèle de genèse dans la troisième et dernière partie de ce document.
B. LA CONVENTION D’APPROPRIATION.
Nous reprendrons peu ou prou la même structure que lorsque nous avons traité de la convention pour expliquer ce que nous entendons par convention d’appropriation. La première section sera réservée à définir ce que nous entendons par appropriation, et à en proposer des modes de mesure, et la seconde, à expliquer pourquoi nous pensons être en droit de parler de convention d’appropriation. 1. Du sens de l’appropriation. Le sens commun de l’appropriation est « l’action d’approprier, de rendre propre à une utilisation » (ex : l’appropriation d’une terre à la culture de la vigne) ou « l’action de s’attribuer quelque chose, d’en devenir propriétaire » (ex : l’appropriation d’une maison)23. De Vaujany identifie globalement trois familles de travaux : « la famille constituée par les gestionnaires et les sociologues des organisations, par les sociologues d’inspiration marxiste, et les sociologues structurationnistes » (De Vaujany, 2001 : 79). • L’appropriation en gestion et sociologie des organisations : de
« l’appropriation d’un outil bureautique » (Alter, 1985) au « processus d’appropriation de la mémoire organisationnelle » (Girod-Séville, 1996), en passant par « l’appropriation de la stratégie » (Torset et Tixier, 2002), la notion a principalement été développée selon le sens commun.
23
Dictionnaire encyclopédique Hachette Multimédia, Edition 1999.
16 • Les fondements marxistes de l’appropriation : dans cette perspective, « appropriation signifie utiliser constructivement, construire en incorporant (…) ; le sujet, qu’il soit affirmé ou impliqué, est le pouvoir essentiel de l’Homme. Pour Marx, l’individu s’approprie la nature qu’il perçoit et vers laquelle il a été orienté en la transformant en quelque sorte en une partie de luimême, quels que soient les effets que cela puisse avoir sur sa présente ou future orientation » (Ollman, 1971, in de Vaujany, 2001 : 80). • La sociologie structurationniste : en dehors de Barley (1986) qui fut parmi les premiers à mobiliser les travaux de Giddens (1984) sur la structuration, les travaux de référence sont à ce niveau ceux de De Sanctis et Poole (1994), tout au moins dans le champ de l’appropriation des technologies de l’information24. La question est donc : dans quelle perspective nous situons-nous ' A cette question, point de réponse immédiate. Elle ne viendra que lorsque nous aurons défini les conditions de la genèse de la convention d’appropriation, suivant en cela le mode de raisonnement Simondonnien dans le champ de l’étude et de la réflexion sur les objets techniques (Simondon, 1958). De la même façon, nous considérons que nous ne posséderons toutes les clés permettant d’ouvrir notre chapelle de référence que lorsque nous aurons étudié les conditions de genèse de cette convention. 2. L’appropriation des nouveaux canaux de distribution : le cas bancaire. De quoi parle-t-on lorsque l’on dit que les conseillers de clientèle en agence doivent s’approprier les nouveaux canaux de distribution ' Pouvons–nous résumer ces nouveaux canaux à une unique composante informatique ' Quels sont les mécanismes d’appropriation en œuvre '... de nombreuses interrogations sont soulevées lorsque l’on parle de cette appropriation des nouveaux canaux de distribution par les conseillers de clientèle en agence. a) Réduire les nouveaux canaux de distribution à la technologie ' Pouvons-nous assimiler les nouveaux canaux à la simple composante informatique ' Nous ne le pensons pas. Il est vrai que le site Internet, ou les plates-formes téléphoniques, en sont fortement imprégnées, et ne pourraient exister sans elle. Mais il s’agit aussi, et peut être surtout, d’êtres humains, de conseillers qui utilisent ces technologies de l’information pour
24
De Vaujany (1999 ; 2001) qui se réclame de ce courant, présente de façon assez détaillée leurs recherches.
17 rentrer en contact avec les clients, et leur fournir un service 25 . En cela, nous nous différencions de travaux comme ceux de De Sanctis et Poole (1994) dont l’objet d’étude est un système de support à la décision de groupe 26 : Ils s’intéressent à la façon dont « de nouvelles technologies telles que le GDSS sont introduites dans les interactions sociales pour apporter un changement comportemental » (op.cit. : 122). Alors que nous observons l’impact de nouvelles entités à composantes humaines et technologiques sur la structure générale et la gestion d’un réseau de distribution intégré, donc sur les liens entretenus à deux niveaux : entre les clients et leur conseiller, et entre les clients et la banque à une échelle plus globale. b) L’appropriation dans la banque de détail. A quoi faisons-nous référence lorsque l’on parle de cette appropriation ' Nous sommes en réalité proches du sens commun de la notion (et donc de la première catégorie de travaux cités supra). Les conseillers se trouvent dans la situation suivante : ils doivent s’attribuer les nouveaux canaux, les connaître, les maîtriser, pour les vendre à leurs clients, afin de respecter les objectifs de ventes imposés par leur direction. En effet, comme nous l’a très justement fait remarquer le directeur des Etudes et du Développement d’une banque nationale : « On les pense comme des canaux, on les vend, en interne et en externe, comme des services ». De quelle manière ' Dans le cas que nous avons étudié, ceci passait par au moins 3 catégories d’actions mises sur pied par la direction : Diffusion de documents internes expliquant le fonctionnement de ces outils, et informant sur leurs évolutions. Formations à l’utilisation des services concernés : démonstrations du fonctionnement du site Internet, simulations d’appels sur la plate-forme entrante, utilisation du service audiotel… Possibilité pour les conseillers d’acquérir des ordinateurs en empruntant à des conditions avantageuses ; accès personnel à Internet offert à titre gratuit, et utilisation gratuite du service de consultation de comptes via le site.
Pour être exact, la composante technologique est plus ou moins développée selon les canaux. Le minitel ou le serveur audiotel n’ont aucune composante humaine (encore que des services audiotel proposent de se contacter un conseiller, en cas de besoin, même si ce n’est pas le cœur de leur service). Cela varie pour le site Internet, en fonction des services qu’il procure (services de call-through : possibilité de rentrer en contact direct avec un conseiller via Internet par un protocole de téléphonie ; chat : possibilité de dialoguer avec un conseiller en temps réel via son écran). Quant aux agences ou aux plates-formes, elles mixent bien évidemment les deux composantes. 26 GDSS : Group Decision Support System ( : 122).
25
18 Outre le contenu de ces services (que propose-t-on aux clients), les conseillers doivent aussi maîtriser les supports permettant d’y accéder (comment les propose –t-on aux clients). Ceci est d’autant plus important que les clients sont souvent rebutés face à l’utilisation de ces canaux, qu’ils réduisent fréquemment à la composante technologique : « Je ne sais pas m’en servir,… Je n’y arriverai jamais… Vous savez, moi, l’informatique… »… sont autant d’arguments opposés aux conseillers lorsqu’ils proposent aux clients d’acheter ces services. Une démonstration est alors souvent nécessaire pour convaincre le client, qu’il s’agisse d’Internet, des services audiotel ou des plates-formes téléphoniques. Le convaincre, mais aussi et surtout le rassurer : outre le manque d’équipement lorsqu’il s’agit de l’Internet, c’est son inquiétude quant à son incompétence à se servir de ces services qui le freine dans son achat, dans son recours à ce service. Permettre de lever les craintes du client et réussir à lui vendre le service : c’est le premier objectif de l’appropriation des nouveaux canaux de distribution par le conseiller de clientèle travaillant en agence. Un second objectif est de nature organisationnelle. Les craintes majeures des conseillers peuvent être condensées autour de deux questions : 1°) A vouloir trop automatiser les contacts, qui peuvent se faire à distance, ne va-t-on pas couper les clients des agences ' ; 2°) Les clients ne risquent-ils pas de ressentir une dégradation de la qualité du service qui leur est fourni ' Ce sont là de pures problématiques organisationnelles, car la réussite de la mise en place de ces structures nouvelles de distribution dépend en grande partie de leur diffusion aux clients via les conseillers. Là encore, l’appropriation a été favorisée par plusieurs actions de la direction : La communication interne a fortement insisté sur le fait que ces canaux, et principalement les plates-formes téléphoniques (à l’origine de la majorité des interrogations) étaient complémentaires à l’agence. Ils furent plus présentés comme des outils de support, qui délestant l’agence de tâches relativement ingrates et peu créatrices de valeur, que des moyens de remplacement de l’agence. Par exemple, la plate-forme sortante effectue les relances téléphoniques pour le conseiller, lui prenant des rendez-vous en agence (ceci est rendu possible par la mise en place d’un agenda électronique partagé). La plate-forme entrante, quant à elle, vise à traiter des appels qui sont normalement destinés aux agences27, mais qui ne nécessitent pas l’intervention
27
A l’heure à laquelle nous rédigeons ce document, toutes les agences de cette banque ne sont pas concernées. Seules certaines agences ont vu leurs appels automatiquement redirigés vers la plate-forme entrante. Mais cette
19 du conseiller (commande d’un chéquier, virement, informations sur les mouvements du compte…). S’axer sur la complémentarité est par exemple un moyen d’amener les conseillers à demander à la plate-forme sortante de prendre des rendez-vous auprès de certains clients de leur portefeuille (via une procédure informatisée). Des visites des plates-formes ont été organisées par la direction, au cours de réunions de formation. Les conseillers ont pu vérifier la qualité des infrastructures mises en place. Une action forte de la direction a été de faire venir les conseillers du réseau pour venir travailler sur la plate-forme entrante. De cette façon, les chargés de clientèle en agence n’ont aucune crainte quant à la qualité du service qui sera délivré à leurs clients : « je sais qu’ils seront aussi bien pris en charge que si c’est moi qui m’en occupe ». Les plates-formes ne concluent presque aucune vente directement avec le client (uniquement des produits bancaires simples, tels une carte bleue). Et les ventes réalisées sont automatiquement reportées sur les objectifs du conseiller concerné. En outre, elles renvoient systématiquement le client vers l’agence dès qu’il s’agit d’un crédit, de la souscription d’un produit d’épargne élaboré (Plan d’Epargne en Actions, par exemple). De nouveau, le conseiller obtient par ce biais des rendez-vous sans avoir du démarcher lui-même le client. Cette banque régionale est ainsi dans la lignée de ses concurrents, en affectant à l’agence le rôle de point d’ancrage de la relation entre elle et ses clients. Est-ce à croire que l’appropriation ne dépend que de la seule direction ' C’est en effet ce qui pourrait ressortir de l’analyse qui précède. Or, nous montrerons dans la troisième partie que ce n’est pas le cas lorsque nous nous pencherons sur les modalités de création de la convention d’appropriation. A ce propos, pouvons-nous vraiment parler de « convention d’appropriation » ' 3. L’appropriation, une convention particulière. Pour montrer que l’appropriation telle que nous venons de la présenter est bien une convention, nous ferons appel à l’axiomatique des conventions présentée dans la première
plate-forme traite aussi de nombreux appels directs, de clients qui la contactent essentiellement pour passer des ordres de bourse en dehors des heures d’ouverture de leur agence.
20 partie, suivant en cela le procédé adopté par Gomez (1994). Cette axiomatique est en grande partie, rappelons-le, basée sur Lewis (1969). Nous pensons qu’il est indispensable de justifier par ce biais notre appellation de « convention d’appropriation », car nous avons cru remarquer que, dans la littérature, il était souvent fait référence à des conventions particulière sans réelle justification de cette dénomination, ou sans recourir à l’axiomatique pour montrer que c’est effectivement une convention28. 1. Sommes-nous dans une situation d’incertitude ' : Dans cette situation, les conseillers sont en situation d’incertitude quant à la façon dont ils doivent aborder ces canaux : doivent-ils tenter de leur faire barrage ' Ou essayer d’en retirer les avantages, tout en veillant à ce qu’ils ne les débordent pas et ne tendent à les remplacer ' Et dans ce cas, comment réussir à les promouvoir auprès de leurs clients29 ' Et comment ces derniers vont-ils réagir ' 2. Est-ce une régularité de comportement ' les problèmes d’incertitude et de coordination, récurrents, imposent une réponse des conseillers. Nous avons vérifié, lors des premières analyses de contenu de nos entretiens, que tous s’appropriaient, à des degrés différents, ces nouveaux canaux de distribution. 3. Les 6 conditions de Lewis son-elles satisfaites ' (C1) Chacun se conforme à R : la nécessité de répondre aux objectifs posés par la direction, et la reconnaissance par tous de l’impératif de connaître à la fois les services offerts par ces nouveaux canaux et leur mode de fonctionnement, impose que chacun s’approprie ces canaux. Ne pas le faire revient à courir des risques quant à la conservation de son emploi. (C2) Chacun croit que les autres se conforment à R : chaque conseiller anticipe que les autres recourent à la convention d’appropriation pour atteindre ses objectifs. Il doit donc y recourir également s’il veut a minima rester à leur niveau (l’objectif final restant la protection de son emploi). (C3) Cette croyance que les autres se conforment à R donne à chacun une bonne et décisive raison de se conformer lui-même à R : Nous venons de donner l’explication : s’il ne se conforme pas à la convention d’appropriation, il a peu de chances de faire aussi bien que
Par exemple : Eymard-Duvernay, 1989 ; Froehlicher, 2000... Cette dernière question s’est posée, et se pose encore, très vivement au sein de l’établissement étudié. La relation client-conseiller a toujours été mise au centre de la stratégie depuis lus d’une dizaine d’années, avec notamment de nombreuses campagnes autour de la notion de « banquier personnel ». Comment faire comprendre aux clients qu’ils auront moins de contact avec cet intermédiaire privilégié, tout en l’assurant que l’on ne cherche pas à l’éloigner de la banque '
29 28
21 ses collègues, et son emploi sera menacé (risque de sanction en acas de non-respect de la convention). « Chaque acteur se positionne relativement à l’ensemble des acteurs du même jeu conventionnel » (Gomez, 1994 : 146). (C4) Chacun préfère une conformité générale à R, plutôt qu’une conformité légèrement moindre que générale : (C5) R n’est pas la seule régularité possible satisfaisant les deux dernières conditions : le contenu de l’appropriation peut varier, et évoluer dans le temps. (C6) Les conditions précédentes (1 à 5) sont connaissance commune : chacun sait que chacun sait que chacun sait, etc.… qu’il y a appropriation.
Telle que nous venons de l’étudier, il semble donc que nous puissions dire que nous sommes en présence d’une convention d’appropriation, à la genèse de laquelle nous allons nous intéresser.
III. PROPOSITION D’UN CADRE DE GENESE DES CONVENTIONS
Les travaux traditionnels de la théorie des conventions étudient leur genèse à partir de la théorie des jeux. Nous ne reviendrons pas dessus dans cet article, préférant conseiller au lecteur les quelques travaux suivants, qui en offrent une vision assez complète : Urrutiaguer, Batifoulier et Merchiers, 2001 ; Batifoulier, de Larquier, 2001b ; de Larquier, Abecassis et Batifoulier, 2001. En ce qui nous concerne, nous nous écarterons de ces pistes de la théorie des jeux pour nous aventurer sur les chemins de l’encastrement et de l’analyse de réseaux. Nous pensons en effet que la genèse de la convention d’appropriation, et a fortiori d’une multiplicité d’autres conventions, peuvent trouver une explication dans ces perspectives théoriques, dont nous allons faire une rapide présentation, avant de les appliquer à notre cas.
A. ENCASTREMENT ET RESEAUX SOCIAUX.
Après une introduction aux concepts d’encastrement et de réseau social, nous reviendrons sur les postulats épistémologiques des courants qui s’y rapportent. Une
22 comparaison avec ceux de la théorie des conventions permettra de vérifier que nous sommes en mesure de les utiliser pour étudier la genèse de la convention. 1. Présentation des concepts. Encastrement et réseaux sociaux renvoient aux analyses sociologiques qualifiées de structurales (Degenne et Forsé, 1994). L’encastrement est un concept issu de Granovetter, qui le présente dans son article de 1985, « Economic action and social structure : the problem of embededdness » 30 . Il vient s’opposer aux thèses utilitaristes, dont font partie l’économie classique et néoclassique, qui supposent que « les individus ont un comportement rationnel, guidé par l’intérêt personnel et qui est donc très peu affecté par les relations sociales » (Granovetter, 2000 : 75). Or, Granovetter s’oppose à cette thèse, soutenant qu’institutions et comportements sociaux ne peuvent s’analyser sans une prise en compte des « relations sociales courantes qui exercent sur eux de très fortes contraintes » (Granovetter, 2000 : 76). Dans son article, il propose tout d’abord ce que l’on peut qualifier de « troisième voie », intermédiaire aux conceptions sur- et sous-socialisées de l’action humaine en sociologie et en économie. La conception sur-socialisée « implique que les gens suivent automatiquement et inconditionnellement les coutumes, les habitudes ou les normes. Presque tous les économistes analysent les « normes » de cette manière, et les débats sur les « conventions » risquent également de glisser vers cette conception sur socialisée » (Granovetter, 1994 : 84, souligné par nous). La conception sous-socialisée, de son côté, omet toute relation sociale, et ne s’intéresse à l’homme qu’en tant qu’acteur économique rationnel maximisant son utilité. Malgré leurs différences, Granovetter montre qu’elles aboutissent finalement au même résultat, partageant « une même conception de l’action et de la décision [puisque] dans les deux cas, ces dernières sont effectuées par des acteurs atomisés » (2000 : 81). En effet, la version sur-socialisée « traite les modèles de comportement comme s’ils avaient été intériorisés, et qu’ils étaient donc devenus imperméables aux relations sociales courantes » (1994 : 84). L’auteur poursuit en critiquant les travaux de Williamson, emblématique de la théorie institutionnaliste dont il se fait le pourfendeur, en en montrant les insuffisances à partir du postulat selon lequel « les actions que [les acteurs] entreprennent pour atteindre un objectif sont encastrés dans des systèmes concrets, continus de relations sociales » (2000 : 84).
30
L’édition consultée correspond à la traduction française, parue sous le titre : « Action économique et structure sociale : le problème de l’encastrement » dans l’ouvrage Le Marché autrement, essais de Mark Granovetter.
23 Dans l’action, les individus sont donc insérés dans « des relations personnelles concrètes et [les] structures (ou « réseaux ») de ces relations » (2000 : 88). Avec cet angle d’attaque, nous sommes alors autorisés à nous rapprocher de l’analyse structurale des réseaux sociaux telle que nous la présentent Degenne et Forsé : « Les normes sont des effets de la situation structurale des individus ou des groupes, car cette situation suffit à déterminer les opportunités et les contraintes qui pèsent sur l’allocation des ressources et à expliquer les régularités de comportement que l’on peut observer » (1994 : 7). Plus loin, ils apportent des précisions sur l’analyse de réseau : « Elle tente de trouver les régularités de comportements, et les groupes ou statuts qui présentent des régularités, de façon inductive, en analysant l’ensemble des relations. Grâce à quoi elle peut dégager des groupes pertinents a posteriori et comprendre concrètement comment la structure contraint les comportements tout en émergeant des interactions ». Nous développerons plus loin en quoi ceci s’applique au cas que nous avons présenté précédemment. Avant cela, il nous reste à montrer que les présupposés épistémologiques de la théorie des conventions peuvent s’accommoder de ceux fondant les analyses de réseau, permettant la transposition de cette méthodologie d’analyse à la genèse des conventions. 2. Des présupposés épistémologiques contradictoires ' En effet, si la théorie des conventions, telle que nous l’avons présentée, est basée sur des postulats épistémologiques en désaccord total avec ceux de l’analyse de réseau, sa transposition risque de rapidement aboutir à des contradictions insurmontables (Chalmers, 1991). La théorie des conventions peut être considérée comme faisant partie de ce que Favereau dénomme la Théorie Standard Etendue31 (Favereau, 1989). Orléan en dit d’ailleurs : « Cette situation est la conséquence d’un double mouvement : la reconnaissance par la théorie néoclassique de l’importance économique des phénomènes organisationnels et institutionnels ; et la reconnaissance par les « conventionnalistes » de l’importance de la méthodologie individualiste » (Orléan, 1994 : 15). Toutefois, nous avons vu que Granovetter montrait les insuffisances de la perspective néo-institutionnaliste en économie (Williamson, 1975 ; 1985, par exemple), conduisant à une sur-socialisation qui n’aboutit à rien d’autre qu’à rejoindre la condition d’atomicité des acteurs dans le jeu économique (Granovetter, 2000), c'est-à-dire
31
Ceci doit être nuancé : Favereau différencie « les modèles de conventions et d’institutions dans le cadre de la théorie des jeux », qu’ils intègre à la Théorie Standard Etendue, et « les modèles d’X-inefficience et de conventions à la Leibenstein », placés dans le quadrant de la Théorie non Standard (Favereau, 1989 : 280-281).
24 qu’elle rejoint la théorie économique standard, au sens de Favereau. Granovetter montre aussi que son analyse permet de dépasser les limites inhérentes à cette vision, tout en bénéficiant de validations empiriques dont ne peut toujours se prévaloir la théorie néo-institutionnaliste (de nouveau, surtout en ce qui concerne les travaux de Williamson, comme le montre Gabrié, 2001). Ceci n’empêche pas Granovetter de montrer que son approche partage de nombreuses caractéristiques communes avec l’approche néo-institutionnaliste, du moment que « l’on adopte une interprétation générale des choix rationnels » (2000 : 111). Par ailleurs, la présence même de l’article de Mark Granovetter dans l’ouvrage de référence « Analyse Economique des Conventions » de 1994, et le commentaire qu’en fait André Orléan dans l’introduction, peuvent être interprétés comme des marques plus ou moins explicites de reconnaissance de cette analyse des conventions selon les réseaux sociaux. Pour renforcer nos propos, nous reprendrons également Degenne et Forsé (1994). Dans l’introduction de leur ouvrage, ils cherchent à situer l’analyse structurale relativement aux deux « traditions antithétiques » ( : 9) des sciences sociales : l’individualisme et le holisme. Ils montrent alors qu’elle renvoie à une conception particulière de l’individualisme : l’interactionnisme (ou individualisme) structural ( : 16). On ne peut donc pas parler de coupure épistémologique nette entre théorie des conventions et analyse structurale. Les principes de l’encastrement et de l’analyse de réseau tels que nous les avons exposés paraissent donc parfaitement valables pour justifier de la genèse des conventions.
B. APPLICATION A NOTRE CADRE D’ETUDE.
La transposition de ces concepts dans le cas des canaux de distribution nécessite de rappeler que la convention d’appropriation est adoptée par les conseillers de clientèle travaillant en agence. Dès lors, si l’on parle de réseaux de relations sociales, il convient de situer à quels réseaux ces acteurs appartiennent. Une fois ces représentations schématisées, nous les commenterons eu égard à leurs influences respectives sur la genèse de cette convention. 1. L’encastrement des conseillers dans des réseaux sociaux. a) Quels réseaux ' Dans le cadre de leur activité, les conseillers entretiennent des relations sociales avec :
25 Leur hiérarchie : nous réduirons volontairement ces échanges à un rapport de force. La hiérarchie fixe aux conseillers des objectifs, individuels et collectifs, à peine de sanction (réseau de relations hiérarchiques) D’autres conseillers : de la même agence ou d’autres agences. Les interactions entre ces conseillers sont d’ailleurs une des explications à la diffusion de la convention (mimétisme) (réseau de relations collaboratives) Avec les clients : les clients jouent un rôle très important dans cette représentation. Les travaux d’Eiglier et Langeard ont montré que le client était une partie intégrante du système de servuction. Leurs travaux ont été prolongés par d’autres auteurs qui ont montré le rôle qu’ils jouaient dans la définition du service et de sa qualité (ex : Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990) (réseau de relations clients) Ce sont donc là les trois réseaux principaux desquels font partie ces acteurs en tant que conseillers. Mais n’oublions pas qu’ils font aussi partie d’autres réseaux à l’extérieur de l’entreprise, que nous réduirons, arbitrairement, à un seul et unique : le réseau familial et amical. b) Les modalités de la convention. Ces relations sociales vont toutes, à des niveaux différents, influer sur l’adoption de la convention d’appropriation. Ou plus exactement, elles risquent de faire varier le degré d’adoption aux modalités de la convention. Au cours de notre étude de cas, nous avons identifié deux modalités différentes au sein de la convention, qui reflètent les forces en jeu dans sa formation : La modalité normative : nous la diviserons en modalité normative hiérarchique (respect des objectifs imposés par la hiérarchie) et en modalité normative sociale (respect de la convention à peine d’exclusion sociale, de rejet de la part des autres conseillers). La modalité interprétative : on distinguera la modalité interprétative centrée clients (recueil et interprétation de l’opinion des clients concernant le développement des nouveaux canaux de distribution. Leur satisfaction tendra à renforcer la convention, tandis que leur insatisfaction entraînera soit une évolution de la convention, soit une moindre adhésion à la convention) et la
26 modalité interprétative sociale (recueil et interprétation des expériences vécues au sein du réseau familial et amical 2. Genèse de la convention d’appropriation. Les relations sociales dans lesquelles sont encastrés les conseillers de l’agence mènent à l’idée d’une co-construction de la convention d’appropriation. Pourquoi une coconstruction ' Car ces relations sont autant d’éléments externes pesant sur le mode de constitution de la convention au sein de la population des conseillers. Le schéma suivant, et les quelques explications subséquentes, cherchent à éclairer nos propos. La convention résulte de la confrontation des quatre réseaux de relations auxquels appartiennent les conseillers.
FIGURE 2 : La genèse de la convention d’appropriation.
Réseau de relations hiérarchiques
Incitation à la création de la convention / Normatif
Affecte la nature du
Réseau de relations collaboratives
Impératif social d’adhésion à la convention (Lewis) / Normatif
CONVENTION D’APPROPRIATION
Anticipation des conseillers / Interprétatif
Anticipations personnelles à partir d’expériences antérieures /
Réseau de relations clients
Réseau familial et amical
a) Le réseau de relations hiérarchiques. Nous avons parlé du rôle normatif joué par la hiérarchie, qui va influencer la genèse de la convention. Donc, si ce sont les conseillers qui vont effectivement être à l’origine de la création de cette convention, l’émergence de celle-ci n’en aura pas moins été favorisée par les
27 différentes actions de la direction (cf. partie 2) visant à favoriser l’appropriation des nouveaux canaux (communication interne, accès gratuits, formations et mise en situation) par les conseillers. L’impératif de convention se caractérise par l’existence du risque de sanctions (respect des objectifs). b) Le réseau de relations collaboratives. Ce sont les liens existants entre les conseillers. Si les phénomènes de mimétisme sont plutôt liés, selon nous, au développement et à la diffusion de la convention, pour ce qui touche à la création de la convention, il s’agit de trouver une réponse aux risques de sanctions de la direction. C’est une des explications de l’émergence de la convention. c) Le réseau de relations clients. Les conseillers anticipent les réactions de leurs clients au développement de ces nouveaux canaux. On peut postuler que le niveau d’appropriation, donc le degré de développement de la convention, sera d’autant plus fort qu’ils anticiperont des réactions positives de la part de leurs clients. A l’inverse, si après les premières expériences, le feedback des clients se révèle négatif, le degré d’appropriation risque d’avoir tendance à diminuer. C’est du moins ce que nous ont permis de constater nos analyses qualitatives jusqu’ici. Cela joue alors plus sur l’évolution de la convention, que sur sa genèse. Dans nos entretiens, ceci a été révélé par des phrases telles que : « la plate-forme... La plate-forme, je l’attendais avec impatience. Et puis très vite, j’ai des clients qui m’ont rappelé derrière, après que la plate-forme les ait contacté. Ils étaient complètement affolés, ils voulaient savoir pourquoi ce n’était pas moi qui les avais contactés, si je n’allais pas partir,... Alors depuis, la plate-forme, je ne leur envoie plus rien, je m’occupe de mes relances tout seul ». Ce pragmatisme est un exemple assez révélateur du comportement de la majorité des conseillers que nous avons rencontrés. d) Le réseau familial et personnel. Nous y incluons les expériences vécues à titre personnel (par opposition à professionnel) par le conseiller. Par exemple : « vous savez, moi, je suis à la compagnie d’assurance Y, alors les plates-formes, je connais... C’est bien, parce qu’on vous répond tout de suite, mais sinon, vous ne tombez jamais sur la même personne, et vous devez toujours tout réexpliquer ». Ce genre de situations négatives, potentiellement vécues (personnellement ou par procuration, i.e. racontées par un membre de sa famille ou des amis) par le conseiller avant même l’arrivée des plates-formes dans son entreprise, tendra certainement à limiter son
28 adhésion à la convention d’appropriation. A l’inverse, une expérience positive vécue dans ce contexte risque d’accroître l’adhésion à la convention d’appropriation. « Je suis rentrée dans une agence qui était pas de la banque A, où les appels agence sont déjà transférés, mais c’est magnifique, c’est calme, il y a une ambiance... Cela se ressent. Et puis même, quand vous vous êtes en entretien, le client, il vient vous voir, il prend rendez-vous, et puis le téléphone sonne sans arrêt, donc notre travail, c’est de décrocher, donc vous imaginez un peu la coupure dans le déroulement de l’entretien. Donc c’est pour ça, qu’inévitablement, ça nous ferait un bien fou...».
29
CONCLUSION.
Notre étude, exploratoire du fait des pistes de recherche sur lesquelles elle se concentre, visait, après avoir fait une présentation rapide de la notion de convention et des conditions de son existence, à montrer l’existence d’une convention d’appropriation comme un des mécanismes de coordination entre des canaux de distribution bancaires. Nous nous sommes ensuite attachés à élaborer un cadre original de genèse de cette convention, dont nous pensons qu’il pourrait s’appliquer plus largement à d’autres types de conventions. Poser cette convention d’appropriation comme mécanisme permettant de coordonner les canaux de distribution au sens de « formule de vente » (Filser, 1989) représente à notre sens un apport intéressant, en tant que les travaux portant sur la coordination des canaux de distribution tels que nous les entendons sont encore, sinon inexistants, très rares. Si il est vrai que la théorie des organisations nous offre des outils déjà fortement développés pour nous aider dans notre travail (travaux sur la coordination intra-organisationnelle : Mintzberg, 1982 ; 1990 ; Malone et Crowston, 1994 ; Bolland et Wilson, 1994 ; Van de Ven, Delbecq et Koenig, 1976 ; Mc Cann et Ferry, 1979...), il n’en reste pas moins que l’étude de l’impact potentiel d’un tiers à l’organisation, mais néanmoins partie prenante du processus de création du service (le client), dans le cadre de la réflexion peut amener à des résultats nouveaux, qui seraient tout à fait utilisables dans la gestion des organisations de services disposant d’un réseau de distribution intégré. C’est d’ailleurs le cas ici, où les interactions entre le client et le conseiller provoquent une évolution de la convention d’appropriation. On peut donc parler, d’une certaine façon, d’une perspective contingente de la coordination intra-organisationnelle. Par ailleurs, relativement à cette convention, nous avons aussi cherché à montrer qu’elle ne se construisait pas, et ne se développait pas, uniquement via les interactions entre les membres d’une même communauté (les conseillers de clientèle). L’éventualité d’une sanction (la non-atteinte des objectifs fixés par la direction engendrant des sanctions pécuniaires) permet d’envisager la genèse des conventions selon une perspective, là encore, contingente. 32 Cette contingence est auto-entretenue par les contacts quotidiens entre le conseiller et les clients, et par l’existence permanente de la menace de sanction que fait planer la hiérarchie.
32
Ce type de situation a aussi été mis en évidence par la théorie des jeux (Leibenstein, 1982), où l’on parle alors de convention externe (de Larquier, Abecassis et Batifoulier, 2001).
30 Ce modèle n’est toutefois qu’exploratoire, donc non finalisé et largement améliorable. Nous sommes conscients de certaines de ses limites : Les réseaux de relations sociales sont considérés comme indépendants entre eux, ce qui n’est pas toujours le cas. Il faudrait donc parvenir à faire apparaître ces liens. Nous accordons peut être une importance trop importante à la direction et à ses aspects normatifs afférents, supposés influencer lourdement la création de la convention. En cela, on pourrait reprocher un caractère peut être fonctionnaliste à notre travail. Enfin, les pondérations accordées à chaque réseau dans le processus de création de la convention ne sont pas du tout évoquées. Cela serait pourtant intéressant, car permettrait tant aux conseillers qu’à la direction de distinguer les leviers essentiels sur lesquels agir pour améliorer l’efficience et l’efficacité de la convention, donc améliorer la coordination entre les canaux de distribution.
31 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. • Alter N. (1985), La bureautique dans l’entreprise, Editions ouvrières. • Batifoulier P., de Larquier G. (2001b), « La convention en théorie des jeux », in Batifoulier P. (dir), Théorie des conventions : 99-126, Economica. • Batifoulier P., Larquier (de) G. (2001a), « De la convention et de ses usages », in Batifoulier P. (dir), Théorie des conventions : 9-31, Economica. • Bolland J.M., Wilson J.V. (1994), « Three faces of integrative coordination : a model of interorganizational relations in community-based health and human services », Health Services Research, vol. 29, n° 3, p 341 • Boltanski L., Thévenot L. (1991), De la Justification, les Economies de la Grandeur, Gallimard. • Chalmers A.F. (1991), La fabrication de la science, Ed. La Découverte, Paris. • Crowston K. (1997), “A coordination theory approach to organizational process design”, Organization Science, Vol. 8, n°2, March-April, pp 157-175 • Degenne A., Forsé M. (1994), Les réseaux sociaux, une analyse structurale en sociologie, Armand Colin, Paris. • Desanctis G. et Poole MS. (1994), « Capturing the complexity in advanced technology use : Adaptative structuration theory », Organization science, vol. 5, n° 2 : 121-146. • Dupuy J-P. (1989), « convention et common knowledge”, Revue Economique, Vol. 40, n°2 : 361-400. • Dupuy J-P., Eymard-Duvernay F., Favereau O., Orléan A., Salais R., Thévenot L. (1989), « L’économie des Conventions, introduction au numéro spécial », Revue Economique, Vol. 40, n°2 : 141-145. • Eiglier P., Langeard E. (1987), Servuction, le marketing des services, Mc Graw Hill, Paris. • Eymard-Duvernay F. (1989), « conventions de qualité et formes de coordination », Revue Economique, Revue Economique, Vol. 40, n°2 : 329-359. • Favereau O. (1989), “Marchés internes, marché externes”, Revue Economique, Vol. 40, n°2 : 273-328. • Filser M. (1989), Canaux de distribution, description, analyse, gestion, Vuibert, Paris. • Froehlicher T. (2000), « La dynamique de l’organisation relationnelle : conventions et réseaux sociaux au regard de l’enchevêtrement des modes de coordination », Finance, Contrôle, Stratégie, Vol. 3, n°2 : 113-143. • Gabrié H. (2001), « La théorie Williamsonienne de l’intégration verticale n’est pas vérifiée empiriquement », Revue Economique, Vol. 52, n°5, sept : 1013-1039. • Giddens A. (1987), La constitution de la société, PUF, (édition originale : The constitution of society, (1984), University of California Press. • Girod-Séville M., (1996), « Une approche modulaire de la mémoire organisationnelle », communication au colloque « Mémoire organisationnelle et dynamique innovatrice », Université de Compiègne • Gomez P.Y. (1994), Qualité et théorie des Conventions, Economica, Paris.
32 • Gomez P-Y (1997), « Economie des conventions et sciences de gestion », in Simon Y., Joffre P., Encyclopédie de Gestion, Tome 1, Article 54 : 1060-1072, Economica. • Gomez P-Y (1998), « De quoi parle-t-on lorsque l’on parle de conventions ' », Introduction à la Journée d’Etude sur la théorie des Conventions, 5 mai 1998 (IAE de Nantes). • Granovetter A. (1994), « Les institutions économiques comme constructions sociales : un cadre d’analyse », in Orléan A. (dir.), « Analyse économique des conventions » : 79-94, Puf. • Granovetter M. (2000) « Action économique et structure sociale : le problème de l’encastrement », in Le Marché autrement, essais de Mark Granovetter, Desclée de Brouwer, Coll. Sociologie Economique, 2000 : 75-114 (article original : Granovetter M. (1985), « Economic action and social structure : the problem of embededdness », American Journal of Sociology, Vol. 91, n°3 : 481-510). • Gulati R., Garino J. (2000), “Get the right mix of Bricks and Clicks”, Harvard Business Review, vol.78, n°3, May-June. • Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin Company. • Larquier (de) G., Abecassis P., Batifoulier P. (2001), « la dynamique des conventions en théorie des jeux », in Batifoulier P. (dir), Théorie des conventions : 127-160, Economica. • Leibenstein H. (1982), « The prisonner’s dilemna in the invisible hand : an analysis of intra-firm productivity », The American Economic Review, n°2 : 92-97. • Lewis D. (1969), Conventions, a philosophical study, Harvard University Press. • Malone T.W., Crowston K. (1994), “The interdisciplinary study of coordination”, ACM Computing Surveys, Vol. 26, n°1, March, pp 87-119. • Mc Cann J.E., Ferry D.L. (1979), “An Approach for Assessing and Managing Inter-Unit Interdependence”, Academy of Management Review, vol. 4, n°1, pp 113-119. • Mintzberg H. (1982), Structures et dynamiques des organisations, Economica, Paris (éd. originale : The Structuring of Organizations, 1979). • Mintzberg H. (1990), Le management, voyage au centre des organisations, Editions d’Organisation (Edition consultée : troisième tirage 2000). • Montmorillon (de) B. (1999), “Théorie des conventions, rationalité mimétique et gestion de l’entreprise”, in Koenig G. (coord), De Nouvelles Théories pour Gérer l’Entreprise du XXIème siècle, Economica, Paris, pp 171-198. • Orléan A (1989), « Pour une approche cognitive des conventions économiques », Revue Economique, Vol. 40, n°2 : 241-272. • Orléan A. (1994), « Vers un modèle général de la coordination économique par les conventions », in Orléan A. (dir.), « Analyse économique des conventions » : 9-40, Puf. • Ramaux C. (1996), « De l’économie des conventions à l’économie de la règle de l’échange et de la production », Economie et Société, Série Economie du travail, n° 11-12. • Romelaer P. (1999), Quelques problèmes de la théorie des conventions, Cahier de recherche CREPA, n° 43.
33 • Salais R. (1989), « L’analyse économique des conventions du travail », in Orléan A. (dir.), « Analyse économique des conventions » : 199-240, Puf. • Simondon G. (1958), Du Mode d’Existence des Objets Techniques, Aubier, Coll. Philosophie, 2001 (Edition consultée : 2001) • Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. (1996), Marketing Channels, Prentice Hall International Editions, London, 5th Edition (1st edition 1977). • Torset C., Tixier J. (2002), Appropriation de la stratégie par les middle managers : une étude exploratoire, Communication au 11ème colloque de l’AIMS, ESC-EAP. • Urrutiaguer D., Batifoulier P., Merchiers J. (2001), « Peut-on se coordonner sur une base arbitraire ' Lewis et la rationalité des conventions », in Batifoulier P. (dir), Théorie des conventions : 62-95, Economica. • Van de Ven A., Delbecq A.L., Koenig R. (1976), “Determinants of coordination modes within organizations”, American Sociological Review, Vol. 41 : 322-388, April. • Vaujany (de) F-X. (1999), Du management stratégique des NTIC au management stratégique de l’appropriation des NTIC, Communication au 9ème colloque de l’AIMS. • Vaujany (de) F-X. (2001), Gérer l’innovation sociale à l’usage des technologies de l’information : une contribution structurationniste, Thèse en Sciences de Gestion, soutenue le 20 décembre à l’université Jean Moulin Lyon 3. • Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. (1990), Delivering quality service, balancing customer perceptions and expectations, The Free Press, New York.