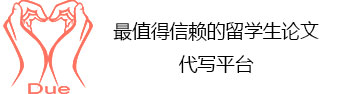服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈Happiness
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Qui de nous ne s'est sollicité sur ce thème un jour' Qui n'en été scruté depuis la bouche d'un ami, d'un agréable petit enfant curieux, ou d'un philanthrope vieillard qui résumait les essences de sa vie. Y’a t'il une personne qui s’obstine d’être heureuse '
Faudrait-il peut être définir d’abord, le bonheur; en le définissant primairement tout en essayant durant la prolifération de ce que j’écris d’approfondir sa signification, pour en arriver à la fin à une explication plus que convaincante sinon attirante. Définissons alors au moins provisoirement, et comme début le bonheur: il est ce dont chacun rêve, non pour but, autre que le vivre éternellement, si ce n'est le sentir, et l'assimiler... Non en vue d’un autre but (comme on désire la possession pour la puissance et la puissance pour le plaisir) mais pour lui-même, et sans qu’il soit besoin ni possible encore d’en trouver ou approvisionner ou justifier la valeur de ce désir ou son utilité... Tous les hommes s’accordent à appeler bonheur ce bien suprême qui est l’unité présupposée des fins humaines. Mais, comme le bonheur est toujours en avant de nous-mêmes, désiré plutôt que possédé, il est impossible de le décrire et difficile de le définir… «À quoi bon être heureux'» À cette question passée sur des milliers de générations pour passer à travers des dizaines de philosophes, qui lui ont attribué un sens saugrenue, dont la réponse belle et complète pour nous, ne voit pas encore le jour. La question a été posée, et le chemin de sa réponse est toujours recherché. Tout tend vers sa satisfaction en rependant à cette question… Malheureusement il n’est pas de réponse, du moins provisoirement et c’est à quoi le bonheur se reconnaît: il est ce qu’on désire absolument, et qui tout seul vaut la satisfaction ultime vers quoi toutes les satisfactions tendent, le plaisir complet sans lequel tout plaisir est incomplet… C’est une sorte de but dont on veut arriver, mais sans but lui-même. En tout cas sans autre but que lui-
même.. Et il est le contentement sans reste. Le bonheur est le souverain bien ; le souverain bien est le bonheur. Mais sachez; ce dont je viens de citer comme définition n’est pourtant que nominale. C’est ce qui explique que les hommes ou même moi et vous qui lisez ces lignes; nous nous entendons moins encore pour ne pas dire presque jamais sur la chose que signifie ce mot pour chacun de nous… et je dit bien « chose ». Je m’explique : tous appellent « bonheur » ce qu’ils désirent absolument, mais tous ne désirent pas les même choses… D’où on déduit que ce n’est pas le mot qui importe mais la chose. Mais c’est quoi la chose dans notre cas ' Bien c’est le bonheur lui-même, qui en effet n’est pas un mot, ni malheureusement une chose. Qu’est-il' Peut-on l’atteindre' Comment' La seule repense que je voix est la philosophie et la vie et dire la vie c’est en fait la philosophie. Et ces deux derniers trouvent là l’objet principal de leurs préoccupations. C’est l’enjeu de vivre et de penser.
En lisant les lignes qui précèdent, un bon intellectuel s’apercevra de l’écho de l’analyse aristotélicienne… Un écho qui dit que tout être tend vers son bien, et le bonheur est le bien de l’homme. Il est donc, dans toute action, dans tout choix, la fin que nous visons et en vue de laquelle nous faisons tout le reste. Fin parfaite, dit Aristote, en ceci que le bonheur est toujours désirable en soimême et ne l’est jamais en vue d’une autre chose. Rien ne sert qui ne serve, directement ou indirectement, au bonheur ; mais le bonheur, lui, ne sert à rien. Tout sert au bonheur comme fin, mais le bonheur ne sert a rien, car lui-même est une fin… Il ne peut être ni instrument ni moyen ; je m’explique : si on était heureux pour une autre chose, c’est cette autre chose qui serait le bonheur… Le bonheur est une fin, uniquement fin et, par là, fin absolue… Autrement dit : Tout ce que nous choisissons est choisi en vue d’une autre chose, à l’exception du bonheur, qui est une fin en soi… Il est la fin des fins. Par la même logique on pourrais avancer que le bonheur n’est pas un bien parmi d’autres, il n’est même
pas, en toute rigueur, un bien… Car alors seraient suprêmement désirables non le bonheur, mais lui avec ou plus les autres biens, et ce serait cette somme qui serait le bonheur… Et pourtant la chose la plus désirable de toutes, qui seule est capable d’apaiser le désir. Sans le bonheur, en effet, nous n’en finirions pas de désirer. En étant troublé de choisir indéfiniment sans cesse une chose en vue d’une autre dans la vie, de façon que ce que je choisis maintenant ne me suffit pas ou pour une raison je devrais changer de cette chose et en choisir une autre, de sorte que le désir serait futile et vain ; de cette manière nous ne connaîtrions ni contentement ni repos. Car nous ne nous sommes pas convaincu à une limite de désir, et cette poursuite indéfinie du plaisir nous en éloignerait (du repos) sans cesse…
Certes les cervelles cruels et surtout la majorité des universitaires dirons avec ironie que c’est bien en effet ce qui se passe, et qu’il suffit de penser le bonheur pour constater son absence. Sans doute ils diront aussi que c’est ce qu’on appelle philosopher, activité bien vaine (le fait de penser le bonheur) si le bonheur était là, et qui ne se justifie que du malheur ambiant… Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes, cette confirmation comme elle se trouve chez le poète, elle est aussi admise par le philosophe: en effet si elle tend au bonheur, et parce qu’elle tend au bonheur, la philosophie est d’abord réflexion sur le malheur, pour le vaincre. Il s’agit de comprendre pourquoi nous vivons si mal, ou si peu, et pourquoi, quand bien même nous ne manquons de rien, le bonheur toujours nous manque... Qu’est-ce que je serais heureux si j’étais heureux!... Il est donc juste qu’on ne le soit jamais, puisqu’on attend, pour le devenir, de l’être déjà. C’est le cercle du manque, où le bonheur, nécessairement, est manqué. C’est ce cercle qu’il faut à mon avis, explorer d’abord, pour en sortir…
Comment en sortir ' Le bonheur est désirable, c’est la moindre des logiques qu’on peut sortir avec depuis ce que je venais de dire dans les lignes précédentes… d’ailleurs c’est ce que montrait Aristote, il disait même que c’est suprêmement désirable, et c’est ce qui le définit.. Mais qu’est-ce que le désir' Platon, dans son oeuvre « Le Banquet », avait déjà répondu. ´´Le désir est manque´´: Celui qui désire, désire une chose qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas. Comment désirer être grand ou fort quand on l’est déjà' Tout au plus peut-on désirer être plus grand ou plus fort - ce qui n’est pas, car si on dit que voila, nous avons atteint notre désir, celui d’être le plus fort c’est que nous ne pensons plus que nous pouvons être plus fort que ça. Ou encore, pour quelle raison être encore plus fort alors qu’on l’est... On objectera qu’on peut, étant en bonne santé, désirer la santé, étant riche, désirer la richesse. Mais Platon répond qu’on veut alors, jouir de ces biens pour l’avenir aussi: on désire, non la santé ou la richesse qu’on a, mais leur continuation, que l’on n’a pas. Logiquement donc, tout désir, par conséquent, est d’absence: Ce qu’on n’a pas, ce qu’on n’est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l’amour. Quel rapport avec le bonheur' Celui-ci: parce que le désir est manque, et dans la mesure où il est manque, le bonheur, nécessairement, est manqué. Certains philosophes arrivent même à dire que quoi qu’on en dise, on ne sera jamais heureux, ni personne dans ce monde.. Les vrais philosophes, même de leur vivant, sont déjà morts, et eux seuls sont heureux véritablement: leurs pensées philosophiques leurs a révélé le secret du bonheur, et comme tout vivant de ce monde n’atteint jamais ce bonheur, ils sont considérés comme non de ce monde, et donc ne pouvant être que morts… le bonheur, pour Platon, est d’outre-tombe et suppose qu’on fuit, dès ici-bas, de ce monde dans l’autre... Autrement dit si quelqu’un arrive à être heureux c’est qu’il a touché un bout de l’autre monde… mais le contraire n’est nul à discuter ici… On ne peut suivre ici
les analyses de Platon, du Banquet au Philèbe ou au Théétète, du Gorgias au Phédon ou à La République. Mais chacun peut se suffire de son expérience. Si le désir est manque, je manque toujours de ce que je désire, or le manque est une souffrance, et je ne désire jamais ce que j’ai puisque le désir est manque, et lorsque le manque est comblé, le désir n’existe plus... Tantôt, donc, je désire ce que je n’ai pas, et j’en souffre; tantôt j’ai ce que dès lors je ne désire plus... De là la tristesse, pour l’enfant, des après-midi de son jour d’anniversaire, quand le jouet tant rêvé, en son absence (absence du jouet), échoue (puisqu’il est là), à maintenir vivace le désir qui le visait. De là aussi la tristesse des amants, quand la présence tant souhaitée de l’autre triomphe du désir que, en son absence, ils en avaient... Kattoussa présente, Kattoussa disparue... C’est la même femme pourtant, mais l’une est impossible à aimer, et l’autre à oublier. On désire ce qu’on n’a pas, donc on ne désire plus ce qu’on a, et qu’on désirera à nouveau si on le perd. Souffrance du manque, indifférence de la possession, horreur du deuil... La vue ferait le bonheur de l’aveugle puisqu’elle lui manque, mais échoue à faire le nôtre puisque nous voyons. Et la mort ou la fuite d’un être cher, lui rendant soudain son urgence et son prix, semble briser un bonheur que sa présence pourtant était incapable de donner... Le piège est terrible où nous sommes enfermés: la vue ne pourrait rendre heureux que des aveugles, mais pour combien de temps' Et l’amour, comme passion, que des amants malheureux… C’est pourquoi, comme dit le poète, il n’y a pas d’amour heureux, et il ne peut y en avoir tant que l’amour est manque lorsqu’il n’est pas là... Mais imaginons Madame Tristan, et qui ne connaît pas l’histoire de Iseut et Tristan' L’histoire divine de l’amour chez les grecs… comment faisait-elle pour tant aimer son amour, en sa présence et dans son absence ' D’après ce que j'avançais dans les lignes précédentes, chacun devine assez ce qu’il en fut advenu : la passion d’Iseut ne se nourrit que du manque de Tristan, et le bonheur qu’elle souhaitait, comblant ce manque, se fût aboli, par là
même, comme bonheur... Comment désirer ce qu’on a' Comment ne pas souffrir de ce qui manque' Il n’y a pas d’amour heureux, ni de bonheur sans amour: il n’y a pas de bonheur du tout. Schopenhauer, mieux que Platon ou que quiconque, a dit ici l’essentiel… L’homme est désir et le désir est manque... C’est pourquoi, pour Schopenhauer comme pour le Bouddha, toute vie est souffrance: Vouloir, s’efforcer, voilà tout leur être; c’est comme une soif inextinguible. Or tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur... Bien entendu, si le manque est souffrance, la satisfaction est plaisir. Mais cela ne fait pas un bonheur: Tout désir naît d’un manque, d’un état qui ne nous satisfait pas; donc il est souffrance tant qu’il n’est pas satisfait. Or nulle satisfaction n’est de durée; elle n’est que le point de départ d’un désir nouveau ... et pour un terme limitant, Pas de terme dernier à l’effort, donc pas de mesure,(mesurer quelque chose c’est la limiter) et donc pas de terme à la souffrance.... Il n’y a donc pas, il ne peut y avoir d’expérience du bonheur: ce que nous expérimentons, c’est d’abord l’absence du bonheur traduit par le désir, le manque, la souffrance... puis arrive la satisfaction, et donc l’absence de son absence…. Sa présence, donc' Non, et c’est ici que Schopenhauer est le plus profond: ce que nous expérimentons, quand le désir enfin est satisfait, ce n’est certes plus la souffrance (sauf quand un nouveau désir, et cela ne saurait tarder, aussitôt renaît...), mais ce n’est pas non plus le bonheur… Quoi' Au lieu même de sa présence attendue, se crée tout de suite le vide encore de son absence abolie…. Comment ça, Cela s’appelle l’ennui: en lieu et place du bonheur espéré, le creux seulement du désir disparu... Pensée désespérante, n’est ce pas ' Schopenhauer dit: le bonheur nous manque quand nous souffrons, et nous nous ennuyons quand nous ne souffrons plus… La souffrance est le manque du bonheur, l’ennui son absence (quand la souffrance ne manque plus)… Car l’absence d’une absence, c’est une absence encore… du moins c’est ce que je viens de montrer juste maintenant. Ah! Que je serais heureux, si j’avais cette maison, cette voiture, cet emploi, cette femme!...
Voici que je les ai; et certes je cesse alors (provisoirement) de souffrir, mais sans être heureux pour autant… je l’aimait quand je ne l’avait pas, je m’ennuie quand je l’ai... C’est le cercle du manque: tantôt nous désirons ce que nous n’avons pas, et nous souffrons de ce manque; tantôt nous avons ce que nous ne désirons plus (puisque nous l’avons), et nous nous ennuyons... Schopenhauer avait un jour conclut, et c’était la phrase la plus triste de l’histoire de la philosophie: «La vie donc transite comme pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui...» Misère de l’homme … Le chômage est un malheur, mais chacun sait bien que le travail n’est pas pour autant, en tant que tel, un bonheur. Et il est affreux de n’avoir pas de domicile; mais qui serait heureux, simplement, d’en avoir un' On peut mourir d’amour pour une fille, enfin, mais point en vivre: déchirement de la passion, ennui du couple... Il n’y a pas d’expérience du bonheur, il ne peut y en avoir. C’est que le bonheur, explique Schopenhauer, n’est rien de positif, rien de réel: il n’est que l’absence de la souffrance, et une absence n’est rien… La satisfaction, le bonheur, comme l’appellent les hommes, n’est au propre et dans son essence rien que de négatif... Le désir, en effet, la privation, est la condition préliminaire de toute jouissance… Or avec la satisfaction cesse le désir, et par conséquent la jouissance aussi… Le désir s’abolit dans sa satisfaction, et le bonheur se perd dans ce plaisir… Il manque donc toujours et c’est la souffrance, même quand il ne manque plus, et c’est alors l’ennui… le bonheur n’existe qu’en imagination: tout bonheur est d’espérance; toute vie, de déception…
Peut être que Schopenhauer était savant dans tout sauf les sciences physiques… Qui sait' Peut être s'il avait su que la pendule avait toujours un point d'équilibre à un moment donné il aurait formulé sa phrase historique de la façon : "la vie donc transite comme pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui… pour se stabiliser au milieu qui est l'équilibre, il est ni la souffrance ni l'ennui…" Qu'est il alors' On est bien au-delà, ici, des doctrines ou des écoles
des pères de la philosophie…revenons aux simples pensées et à la simple logique comme elle devrais : Sur ce que serait le bonheur, on s’opposent; ou plutôt est ce que je peux m’opposer aux pères de la philosophie sur l’absence du bonheur ou est ce que je me rejoigne à eux ' On est tous d’accord que le bonheur est à désirer toujours ce que tu n’as pas, à mépriser les biens présents, car en faisant cela tu désireras le bien présent, mais aussi dans ce cas la vie s’écoulera incomplète et sans joie… Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et, nous disposons toujours à être heureux, et il est inévitable que nous ne le soyons jamais… Le bonheur manque toujours, c’est pourquoi tout homme veut être heureux, et ne peut l’être, et en souffre... De là le divertissement. On pourrait accepter de n’être pas heureux, si l’on ne devait mourir; ou de mourir, si l’on ne voulait être heureux. Mais cela n’est pas: Il veut être heureux, et ne veut être qu’heureux, et ne peut ne vouloir pas l’être; mais comment s’y prendra-t-il' Il faudrait, pour bien faire, qu’il se rendît immortel; ne le pouvant, il s’est avisé de s’empêcher d’y penser… Il s’agit de combattre (plutôt, de fuir) l’angoisse et l’ennui, qui sont les deux maux de l’homme, et c’est ce qui nous occupe, et qui nous perd… Einstein avait dit un jour : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre» Mais comment le pourraient-ils' Il faudrait accepter l’ennui, donc l’angoisse, et c’est ce que l’on fuit: Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans divertissement, et sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir…. Le divertissement n’est pas un bonheur, mais la dénégation de son absence. Les hommes s’amusent pour oublier qu’ils ne sont pas heureux.
Est-ce si dramatique que ça en a l’air ' ne y en a-t-il pas une autre voix de regarder la situation ' Peut-être, et c’est ce que les philosophes appellent la sagesse. Mais comment la penser' D’abord par opposition à ce qui précède. Par opposition à toute la logique avec laquelle je et nous regardions le sujet dans les lignes précédents… en effet si le divertissement est un bonheur manqué, la sagesse serait un bonheur réussi. Mais comment, si le désir est manque' S’il n’était que cela, il n’y aurait pas d’issue, en effet, pas de bonheur, et le suicide sans doute - ou la religion - serait la meilleure solution. Mais aussi nous serions déjà morts, ou plutôt point encore nés (puisque le manque est une absence et qu’une absence n’est rien), et c’est en quoi la vie, même en le confirmant, reste une réfutation du pessimisme. Tous les hommes recherchent d’être heureux, c’est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre…Mais quel est le secret de tous ceux qui ne se pendent pas, car cela doit être pris aussi en considération… Quel est le motif de vivre' La religion' La peur de la mort' Sans doute, mais cela ne suffit pas… Le bonheur' Comment, s’il n’est jamais là 'Il faut donc qu’il y ait autre chose, quelque chose de réel, de positif, et qui nous pousse à vivre encore, et joyeusement parfois. C’est ce que chacun expérimente, et qu’on appelle le plaisir… Peut-on penser qu’il ne soit que l’absence de souffrance' Si c’est le cas il faudrait autrement généraliser, pour en faire une philosophie, or ce n’est pas le cas, aucune philosophie parrain ne s’est accordé avec ça, Platon lui-même s’y refusé et il fut bien, car sinon ça serait l’histoire du fou qui se tape sur la tête de grands coups de marteau et qui, quand on l’interroge, explique: Oh ! Cela fait tellement de bien quand on arrête !! Nous ne sommes pas fous à ce point… Certes on mange quand on a faim et même, si la nourriture est bonne, quand on n’a pas faim.. Boire quand on a soif et même, si la boisson est agréable, quand on n’a pas soif.. Faire l’amour même sans amour, voyager même si ça nous en importe rien de si positif, dépenser même si on peut débourser pour de plus importantes causes, rire, se
promener, écouter de la musique, discuter de sujets, s’instruire, apprendre, savoir… Autant de plaisirs dont chacun peut goûter la pleine, la souveraine présence . Manquer' De quoi, grands dieux, quand le plaisir est là ' La question par contre qui devrait être posée ici est : Mais peut-il y avoir plaisir sans désir' Sans doute pas. Sans manque ,en revanche, qui peut le nier' Malgré que j’avais pas le manque de soif j’ai tant de plaisir à boire ce boisson si froid ! Malgré mon indifférence et l’incertitude de continuer avec cette fille j’ai tant de plaisir à faire l’amour avec ! La musique qui me réjouit ne me manquait pas avant de retentir ni, a fortiori, pendant que je l’écoute, ni ce voyage dont j'ai si dépensé, ni ces nouveaux coûteux vêtements malgré les bons du dieu que je possède, ni ce paysage de printemps, ni ce rire qui explose, ni même, souvent, l’homme ou la femme qui me comble... Il faut donc que le désir ne soit pas toujours ni seulement un manque. Quoi' Alors comment ' Bien la réponse serais ce qu’on appelle : Une puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Le corps en sait plus long là-dessus que nos philosophes… mais je ne parle pas seulement de ce que la cervelle de la plupart parmi vous s’en est souvenue directement… C’est légitimement qu’en utilisant les deux mots cités précédemment on pense intuitivement sur la puissance sexuelle , pour désigner la capacité qu’a l’homme de désirer et de jouir. Qui y verrait un manque' C’est l’impuissant qui manque de quelque chose, et point seulement, ni toujours, ni surtout d’un manque... Ainsi existe-t-il une puissance de rire, disons: la gaieté ! Existe-t-il une puissance d’aimer le beau ou le bon, disons: le goût ! Existe-t-il une puissance d’aimer son amour, disons : la conviction, la passion, la patience, la fidélité !! Existe-t-il une puissance de faire l’amour, disons: la libido ! Bref une puissance de jouir, qui est le désir même… Le plaisir et son acte.
Telle est à peu près, contre Platon, Pascal ou Schopenhauer, la leçon d’Épicure et de Spinoza. Que le désir soit manque, le plus souvent, du moins vécu comme tel, c’est entendu, comme aussi que le bonheur par là même soit
manqué… Ce n’est donc pas du bonheur qu’il faut partir, mais du plaisir: plaisir du corps, la jouissance ; plaisir de l’âme, la joie... Du bonheur, nous n’avons en effet, sauf le sage, aucune expérience positive; du plaisir, dirait Épicure, aucune expérience négative aussi… C’est donc le plaisir, non le bonheur, qui est le bien premier: le bonheur ne serait rien sans le plaisir, quand le plaisir, sans bonheur, est encore quelque chose. Pour ma part, écrivait Épicure, je ne sais ce qu’est le bien, si l’on écarte les plaisirs de la table, ceux de l’amour et tout ce qui charme les oreilles et les yeux… Jouir et se réjouir, tel est le bien de l’homme et le commencement de la sagesse. Comment les philosophes pourraient-ils la penser, et comment pourrions-nous les comprendre, si elle n’était déjà ,fût-ce faiblement, en tous' La sagesse pratique (phronèsis) est condition de la sagesse théorique (sophia), et c’est une sagesse, d’abord, du corps… Tout plaisir comme le plaisir du ventre, chez Épicure est le principe et la racine de tout bien; c’est à lui que se ramènent les biens spirituels et les valeurs supérieures… La phronèsis est ici plus précieuse même que la philosophie, qu’elle permet mais qui ne la remplace pas (elle ne remplace pas la philosophie). Mais le bonheur reste le but pourtant, que la phronèsis échoue à atteindre, et qui justifie de philosopher. Qui se contenterait du plaisir sans bonheur. Il faut donc, méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque, lui présent, nous avons tout, et, lui absent, nous faisons tout pour l’avoir… Quelque chose comme une ascension apparaît ici, où hédonisme et eudémonisme se rejoignent: le plaisir est le bien premier; le bonheur, le bien souverain. Reste à penser, pour l’un et l’autre, leur rapport au manque. Ce que je veux montrer, contre Platon et les siens, c’est qu’il s’agit d’un rapport, dans les deux cas (plaisir et bonheur), d’exclusion… Non, certes, que plaisir et manque ne puissent cohabiter: je peux boire en ayant encore soif, manger en ayant encore faim, et telle est, la folie des amants, manquer de la femme que j’aime, même qu’à l’instant je possède, où elle est prêt de mon cœur... C’est le plaisir en mouvement, comme aimait l’appeler Epicure… boire quand on a soif, manger
quand on a faim... qui certes est un bien (ce plaisir en mouvement), comme tout plaisir, mais qui reste habité du manque encore qui le meut et, en quelque sorte, le corrompt ou l’obscurcit. L’affamé ne fait pas un bon gourmet, ni l’amant trop avide le meilleur des amants... Même dans ce cas, pourtant, la rencontre du plaisir et du manque reste conjonction de contraires: la faim comme souffrance et l’alimentation comme plaisir, si elles peuvent exister simultanément, n’en restent pas moins opposées: preuve en est que l’une abolira l’autre et, déjà , l’atténue… Il s’agit donc d’une disjonction exclusive… Tout plaisir est un bien, pour Épicure, toute souffrance est un mal, et ils ne peuvent coexister qu’en s’opposant: le plaisir, loin de supposer toujours le manque, n’apparaît qu’en le supprimant. On dira que c’est en quoi il le suppose, et que l’abolition du manque abolit aussi, par là même, le plaisir... Ici Epicure, bien proche d’Aristote crierait que non. Il existe aussi, outre le plaisir en mouvement, un plaisir en repos ,plus essentiel, il est le plaisir constitutif de vivre et d’être bien, et qui, loin de satisfaire un manque, s’épanouit au contraire quand on ne manque de rien. C’est ce qu’on appellerait aujourd'hui la plénitude: ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas souffrir, ne pas craindre, ne pas regretter... ne pas, ne pas ,ne pas, Les formules sont négatives, le langage reflète déjà la primauté existentielle de la souffrance, mais la réalité voulu est positive suite à la négation du négatif, absolument positive, et la seule positivité qui vaille… j’avais dis auparavant une phrase que je peux terminer maintenant : Le plaisir en repos est le plaisir constitutif de vivre, et la vie même vécu comme plaisir… Une fois cet état réalisé en nous, toute la tempête de l’âme s’apaise, le vivant n’ayant plus à aller comme vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose par quoi rendre complet le bien de l’âme et du corps… Absence de souffrance pour le corps (aponia), absence de trouble pour l’âme (ataraxia) : c’est la plénitude. C’est le bonheur même, à quoi rien ne manque... Plutôt, le bonheur, en tant qu’il est un état spirituel, est l’ataraxie, et elle seule: on peut être heureux en
souffrant, mais point en étant troublé.. Le bonheur est le plaisir en repos de l’âme.
Il faut bien reconnaître qu’une telle simplicité nous laisse perplexes: qui ne préfère boire plutôt que n’avoir pas soif, faire l’amour plutôt que n’en avoir pas envie' Qui ne préfère le mouvement de jouir à la jouissance du repos' Perplexité ,toutefois, n’est pas réfutation. Sommes-nous si bons juges' Avonsnous une telle maîtrise du bonheur' En avons-nous même seulement l’expérience' Le culte exclusif du plaisir en mouvement, le désir futile et vain d’Aristote, est certes dominant en l’homme, et aujourd’hui peut-être plus que jamais… Mais il est aussi, on l’a vu, ce qui nous sépare du bonheur dans le mouvement même qui le poursuit. Il se pourrait, dès lors, que notre perplexité ne mesure que notre éloignement de la sagesse. Si le bonheur est possible, et Épicure avec maintes d’autres philosophes connus, nous disent encore plus: qu’il existe, qu’il l’on vécu, et c’est sur quoi tous les sages à peu près s’accordent, si le bonheur est possible, donc, il suppose une conversion du désir, et c’est cette conversion qu’on appelle la sagesse: désirer non plus ce qui nous manque (ce qui est la voie du malheur ou de la religion de point de vue Platon, Pascal, Schopenhauer...) même pas (ne pas désirer) ce que nous avons (puisque nous pouvons le perdre, car en le désirant, on s’ennuiera, et il deviendra comme si on ne l’a plus, comme si on l’a perdu), même pas ce que nous sommes comme êtres (puisque nous ne sommes rien, comme on l’a vu, car d’après quelques certaines philosophies, surtout celle de Schopenhauer, nous sommes toujours un manque, et le manque est une absence, et l’absence est rien, et donc nous sommes rien, d’après cette philosophie. Remarquez qu’ici j’essaye d’englober et d’expliquer très ouvertement ces philosophies, en vue de les approfondir dans un prochain ouvrage), mais ce que nous vivons, connaissons ou faisons… C’est en effet le point essentiel, sur quoi se rejoignent les trois grandes sagesses du monde et surtout de l’occident, la première l’épicurienne, la deuxième la
stoïcienne, et la troisième celle de l’Orient avec les doctrines de la religion, et qui ces derniers, à leurs façon, la confirment (confirment ce point essentiel)… Il s’agit de désirer le réel ; de l’aimer, si l’on peut ; de l’accepter si l’on ne peut pas. Désirer le réel tel qu’il est, au lieu de le refuser toujours pour désirer l’irréel… Le bonheur est simple comme bonjour, et c’est pourquoi il est si difficile: il n’est qu’un grand oui au monde et à la vie. Mais le premier mouvement, qui est de peur (peur que le réel ne soit pas mon désir, ou mon plaisir), est de dire non, ou oui seulement sous conditions… J’aimerais le monde, s’il n’était précisément ce qu’il est, ou la vie, si elle n’était mortelle, ou cette femme, si elle n’avait tel ou tel défaut… Folie et tristesse…. La sagesse, dans toutes les langues, est à l’inverse: accepter plutôt que refuser, supporter plutôt que haïr, aimer plutôt que mépriser… C’est bien peu, dira-t-on, pour faire un bonheur… C’est oublier l’action, sans laquelle le bonheur en fait ne serait rien. Car le bonheur n’est pas un état ou une disposition de l’existence… Il n’est pas quelque chose qu’on puisse posséder, trouver, atteindre, et c’est pourquoi, en un sens, il n’y a pas de bonheur: le bonheur n’est pas de l’ordre d’un « il y a »… Ce n’est pas une chose, ce n’est pas un étant, ce n’est pas un état: c’est un acte... c’est dans le temps… c’est dans l’âme…
Aristote l’avait déjà vu et Épicure, avec d’autres mots, en serait d’accord ; comme aussi, bien plus tard, Montaigne ou Spinoza . Être heureux, ce n’est ni avoir ni être; c’est faire. Le plaisir en repos n’est pas un plaisir passif, pas plus que l’acte sans mouvement d’Aristote, ou le non-agir des Orientaux, n’est l’inaction ; mais l’acte même de jouir et d’exister, le plaisir d’agir et d’être, quand il est libéré enfin du manque et du refus qui, chez presque tous, le hantent et ,à force de le différer toujours, l’interdisent… On comprend que cet acte vaut par lui-même, et non pour d’autres fruits qu’il serait censé apporter. Si tu plantes des choux pour avoir des choux, explique à peu près Montaigne, mais si tu craindras la grêle ou les voleurs, cela gâchera ton plaisir… De même est la
situation, si tu vis pour être heureux... Agis, donc, non pour le fruit attendu, mais pour le plaisir de l’action: vis, non pour le bonheur, mais pour vivre. C’est le seul bonheur en vérité: le bonheur en acte, c’est l’acte même comme bonheur. Alors seulement le plaisir est pur ,comme disaient les épicuriens, ou plein, ou simple, parce que purifié d’abord du néant de l’angoisse ou le manque qui le séparent de lui-même… Ce néant n’est rien, et il ne cesse pourtant de nous précéder. C’est ce qu’on appelle l’avenir :qui est alors un poison mortel, par quoi nous ne cessons d’ajourner la joie… La vie se perd ainsi à attendre et attendre ; le bonheur commence lorsque l’on n’attend plus.
Une telle expérience - précisément parce qu’elle est absolument simple suppose un bouleversement de notre rapport au temps. Si le désir est manque, presque toujours, c’est qu’il est temporel: le désir est en effet manque à chaque fois qu’il se fait espérance… Arrêtons-nous là ,un instant. On ne peut, on l’a vu, concéder à Platon que tout désir soit manque. C’est au contraire le propre de toute action - et de tout plaisir actif - que d’accomplir un désir qui, au présent, ne manque de rien… Je suis actuellement en train d’écrire; c’est donc que je désire le faire (j’aurais autrement déjà arrêté), et cela pourtant ne me manque pas (puisque je le fais)… Agir, c’est satisfaire un désir qui n’est pas un manque mais, et dans l’acte même, une puissance… Cela n’interdit nullement d’y trouver du plaisir… Au contraire, dirait Aristote, car le plaisir est alors à la fois en acte, (il est puissance de jouir, dirions-nous, mais non jouissance en puissance) et en repos (puisque rien ne lui manque ou ne le trouble) c’est ce qu’on appelle ou plutôt ce que Aristote appelait : l’acte parfait ou energeia. D’où le mot Energie… c’est à cet acte parfait que le plaisir accompagne ; comme la beauté accompagne la jeunesse ; et que le plaisir aussi parachève, car le même acte, sans plaisir, serait imparfait... Ce que Platon dit du désir est donc
vrai (il dit qu’on ne désire que ce dont on manque)… mais Platon dit faux à propos du désir en acte, comme puissance de jouir… mais son point de vue n’est applicable qu'au désir en attente, comme jouissance en puissance… Platon, autrement dit, englobe une vérité :non du désir, mais de l’espérance ! Je peux bien ,écrivant, désirer écrire, me promenant, désirer me promener, aimer mon épouse, désirer encore l’aimer de plus… je peux donc désirer non d’autres mots ou d’autres pas, ou d’autres sentiments d’amour, mais ceux-là mêmes qu’à l’instant je trace ou fais, l’écriture même, la marche pas à pas, ces sentiments d’amour même… C’est même nécessairement ce qui se passe, dans toute action, on ne peut écrire ou se promener ou aimer, sans le vouloir, ni le vouloir sans le désirer… et c’est l’action même, et le plaisir de l’action: le plaisir en acte dans l’acte même! En revanche, je ne peux espérer écrire ce que j’écris ou faire le pas que je fais ou sentir les sentiments d’amour que je sens lorsque je suis prêt de ma femme ou lorsque j’aime ma femme… autrement dit je ne peux espérer tout au plus que les mots, les pas, ou les sentiments à venir, mais pas eux-mêmes !... Or cela, Platon a raison, n’est jamais acquis, je peux rester bloqué devant une page blanche, renoncer devant l’averse ou la fatigue (après le pas que j’étais entrain de faire) ou apprendre la trahison de ma femme (après s’être envahis par son amour)... et donc cela n’est jamais acquis ni présent car nul jamais n’écrira un mot à venir, ne fera un pas à venir, ne sentirait un sentiment à venir.. On n’espère que l’avenir, on ne vit que le présent: entre les deux s’engouffre le manque, où ils s’engouffrent . C’est pourquoi le bonheur est manqué : non du fait du désir, que le bonheur, au contraire, suppose. Mais du fait de l’espérance… Nul peut-être n’a mieux vu la chose, en tout cas en Occident, que les stoïciens. L’espérance, qu’ils appellent parfois désir (epithumia) ,mais en précisant qu’il s’agit d’un désir portant sur l’avenir. Cette espérance est passion pour eux, c’est-à-dire, dans leur langage, un mouvement déraisonnable de l’âme qui s’éloigne de la nature… Le sage ne saurait la ressentir. Il vit au présent et rien ne lui manque: qu’irait-il
espérer' Est-ce à dire qu’il soit sans désir' Au sens où nous l’entendons, point du tout. Mais son désir ne porte que sur le réel ou le présent, présent qui n’est pas un instant mais une durée, et ceci soit pour s’en réjouir, quand il ne dépend pas de lui, soit pour l’accomplir, quand il en dépend… que veux-je dire par là ' On va le voir petit à petit.. Prenons le dernier désir, le désir d’un bien présent qui dépend de moi, les stoïciens lui donnent le nom, qui est le sien, de volonté : C’est la puissance d’agir. Elle est au sage ce que l’espérance est aux fous, et elle est son rapport privilégié au bonheur... Puisque le sage veut tout ce qui arrive, tout arrive comme il veut; il est donc heureux toujours sans espérer jamais. Qu’irait-il espérer, d’ailleurs, puisqu’il est heureux' Et comment ne le serait-il pas, puisqu’il n’espère rien' La même idée, mais poussée à la limite, se retrouve en Orient… Seul est heureux celui qui a perdu tout espoir, dit un texte hindou, car l’espoir est la plus grande torture qui soit et le désespoir le plus grand bonheur… Euuf pour nous, ça ressemblerait à un Paradoxe' Assurément: puisque l’opinion, (la doxa) est du côté du manque, puisque la majorité et de l’avis du manque et que nous sommes déjà là entre autre discutant du bonheur de point de vue manque ou non, alors dans ce cas toute sagesse est paradoxale et passera pour folie aux yeux des fous. Mais qu’importe l’opinion puisqu’on discute philosophiquement' Le réel ne manque jamais, voilà le point, et l’irréel manque toujours. L’expérience, pour chacun, tranchera .
La notion de volonté, telle que les stoïciens la pensent, nous conduit à la morale. On reproche souvent au bonheur d’être immoral, soit parce qu’il serait égoïste, soit parce qu’il dissuaderait d’agir. Les deux reproches vont d’ailleurs de pair… S’il n’espère rien, dira-t-on, si rien ne lui manque, le sage restera inactif, il n’a aucun acte à réaliser (et vous vous souvenez de la notion d’acte sur laquelle j’ai noté)… Qu’en est-il alors si ce sage était malheureux ou encore qu’en est t‘il du malheur ou de l’injustice ' Et voila que là, C’est confondre à nouveau l’espérance et la volonté ... Loin qu’on ne veuille jamais que ce qu’on
espère ; comme s’il fallait espérer d’abord pour vouloir! ; On n’espère, au contraire, que là où l’on est incapable de vouloir. Ainsi espère-t-on le beau temps, parce que l’on n’y peut rien ; on espère avoir une femme fidèle amoureuse, parce que l’on n’y peut aussi rien… Mais qui, quand il en est capable, espérerait agir' Hehe, pourquoi espérer, alors qu’il est déjà capable ! La volonté ne fait qu’un avec l’acte (vouloir sans agir, ce n’est pas vouloir); elle ne saurait donc s’identifier à l’espérance, qui suppose au contraire que l’acte n’ait pas lieu ou ne soit pas en notre pouvoir… Le paralytique peut bien espérer marcher; pour l’homme sain, sa volonté lui suffit. C’est en quoi toute espérance est passive ; on n’espère jamais ce qu’on fait, on ne fait jamais ce qu’on espère ; et toute action, en quelque chose, désespérée. « J’espère guérir » dit le malade, « j’espère être reçu à mon examen » dit l’étudiant, « j’espère que nous allons gagner les élections » dit le militant... C’est que cela ne dépend pas seulement de la volonté.de l’espérant qui est alors la personne. Parce que, qui dirait, au présent: J’espère me soigner, j’espère travailler, j’espère militer '... Et qui ne s’est jamais soigné, qui a jamais travaillé ou milité , si ce n’est au présent' Le problème n’est plus d’espérer ,alors, mais de vouloir. On dira qu’on se soigne parce qu’on espère guérir, qu’on travaille, qu’on milite parce qu’on espère le succès ou la victoire... Sans doute est-ce ainsi que l’on imagine la chose, mais c’est notre part d’impuissance ou d’ignorance. La vérité ,c’est qu’on se soigne, qu’on travaille ou qu’on milite non parce qu’on espère ceci ou cela (d’autres espèrent la même chose, qui ne le font pas), mais parce qu’on le veut . Peut-on agir, pourtant, sans espérer' Oui, répondent les stoïciens, et c’est ce qu’on appelle la vertu. La vertu, est en effet adoptée pour elle-même, non point par crainte ni par espoir, et c’est ce que Kant au fond confirmera. En effet Kant est survenu après les stoïciens et l’un de leurs élèves. Agir dans l’espoir de quelque chose (fût-ce de la vertu), ce n’est pas agir vertueusement… De là ce que Marc Aurèle appelait « la morale parfaite » : c’est vivre chaque jour, accomplir chaque acte comme si c’était le dernier...
La vertu, comme le bonheur, est désespérée: là où est le souverain bien, il n’y a accès « ni à l’espoir ni à la crainte », disait Sénèque dans son livre « la vie heureuse »... Il est donc vain d’espérer la vertu puisqu’elle ne dépend que de notre volonté et triste d’espérer le bonheur puisque cela suppose qu’on ne l’a pas... Bonheur et vertu, loin de s’opposer, se rejoignent: ils sont le triomphe de la volonté sur l’espérance, et c’est en quoi aussi ils sont liberté... Le sage fait tout ce qu’il veut puisqu’il veut et ne veut que tout ce qu’il fait… Ne rien attendre, disait Marc Aurèle dans son livre Pensées, ne rien fuir, mais te contenter de l’action présente...
Comment ne serait-elle pas bonne, cette action, puisqu’on ne fait jamais le mal que dans l’espoir d’un bien, et le bien, moralement parlant, qu’à la condition de n’en rien espérer' Est-ce possible' Les stoïciens eux-mêmes en doutaient; mais ils ont tracé la voie, où chacun au moins peut cheminer: espérer un peu moins, vouloir un peu plus... C’est le présent de vivre. Et sans doute n’est-ce pas la même chose de trouver son bonheur dans la vertu comme le stoïcien ou sa vertu dans le bonheur comme l’épicurien; il reste que l’un ne va pas sans l’autre, pour le sage, et c’est à quoi on le reconnaît.
Est-ce à dire qu’il n’est de bonheur que pour le sage' Ce serait faire du bonheur - et d’ailleurs aussi de la sagesse - un absolu qui nous l’interdirait. En vérité, personne n’est sage tout entier, ni fou, et tout bonheur en cela est relatif: on est plus ou moins heureux, et c’est ce qu’on appelle être heureux. Qui voudrait l’être absolument ne le serait jamais, et c’est en quoi le bonheur se distingue de la félicité (si l’on entend par là un bonheur absolu), et suppose qu’on y renonce.
On ne peut donc accepter ce qu’écrit Kant, à savoir que, pour l’idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire… À ce compte-là, on ne serait jamais heureux, et il ne s’agirait tout au plus que d’être digne de le devenir dans cette vie, ou dans une autre vie: et dans ce cas il n’y aurait plus que la morale et la religion… Cette félicité illusoire et impossible (ou idéale, comme dit Kant, non de la raison mais de l’imagination) est peut-être l’obstacle principal qui nous sépare du bonheur réel, toujours relatif, et qui ne va pas sans une part de deuil ou de renoncement. Cela est vrai, certes, des félicités paradisiaques que la religion promet : abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, dira Marx, est l’exigence que formule son bonheur réel. Mais cela est vrai aussi, et peut-être surtout, des rêves terrestres que chacun se fait. Comme la fortune, la gloire, le prince ou la princesse charmante... Rêves qui ne seraient que dérisoires s’ils ne faisaient de notre vie, par contraste, comme un long et douloureux purgatoire… Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre.. Et par retour l'abolition de l’espérance, en tant que bonheur illusoire du sujet, est ainsi, pourrait-on dire pour paraphraser Marx, l’exigence que formule son bonheur réel…
Ce chemin de la désillusion est le chemin même de la philosophie, dans ce qu’il a de paradoxal: il faut cesser de croire au bonheur comme félicité pour pouvoir le vivre comme bonheur... Pas de bonheur, ici encore, en tout cas pas de bonheur réel car on peut être heureux sans doute, dans la foi, par la simple pensée d’un bonheur attendu; mais le bonheur ne vaut alors que ce que vaut cette pensée, genre: dans ma foi je suis heureux avec la femme fidèle, amoureuse, sentimentale, féminine que j'ai… je suis sur de mes pensées à l'instant où je les penses, mais c'est aussi un bonheur attendu et donc construit dans mes pensées…
Pas de bonheur, donc, pas de bonheur réel, sans une part de désespoir: le bonheur n’est possible comme bonheur relatif qu’à qui comprend qu’il est impossible comme bonheur absolu. C’est aussi la leçon de Freud: pas de bonheur sans deuil, et sans le deuil, d’abord, du bonheur.
Cette relativité du bonheur pose le problème de la béatitude, qui est le bonheur des sages et dont la tradition philosophique semble bien faire un absolu. Que veux je dire par là' Et quelle différence alors entre la béatitude et ce que nous appelons ici la félicité' Il s’agit, dans les deux cas, d’absolus, si l’on veut, en ceci qu’ils ne peuvent être augmentés… Mais l’absolu de la félicité est un absolu quantitatif et la béatitude en est un qualitatif… La félicité est quantitative, donc un maximum, (comme dit d'ailleurs Kant, en utilisant toujours le terme maximums au lieu d'absolutos) de bien-être ou de plaisirs, ce qui est comme notion un peu contradictoire et impossible à vivre.. Alors que la béatitude est un absolu qualitatif ou, mieux, spirituel, car ce n’est pas non plus un maximum intensif. Un absolu spirituel tel que s’il ne peut être augmenté, ce n’est pas qu’il est le plus grand possible mais qu’il n’est plus de l’ordre, le contraire, d’une grandeur, il n'est plus mesurable, il est indépendant de la quantité, car la qualité s'estime en chacun de nous indépendamment l'un de l'autre... L’ataraxie, chez Épicure, n’est pas un maximum mais un équilibre; la béatitude, chez Spinoza, n’est pas un maximum mais une perfection… C’est pourquoi elles ne peuvent être augmentées, et c’est ce qui les distingue en effet du bonheur ordinaire qui est toujours un plus ou moins de bonheur . "Le bonheur, disait par exemple Épicure, peut être de deux sortes: ou bien il est suprême et ne peut être augmenté, comme celui dont jouit un dieu, ou bien il est susceptible d’être augmenté ou diminué… Le premier bonheur est celui des sages, et c’est ce qu’on peut appeler la béatitude. Le second est celui de tout un chacun, donc du sage aussi, et c’est ce qu’on peut appeler bonheur strictement…
Ils se distinguent moins par la grandeur que par la pureté, la paix, l’harmonie… La béatitude n’est pas plus compliquée mais plus simple que le bonheur; ce n’est pas un bonheur infini, c’est un bonheur pacifié. Mais la béatitude se distingue surtout du bonheur par son rapport au temps ou, comme dirait Spinoza, à l’éternité… On ne peut résumer ici le livre V de l’Éthique, qu’il faudrait citer en entier… Toute chose, y montre Spinoza, peut être conçue de deux manières, selon qu’on la considère dans le temps ou dans l’éternité… C’est le cas aussi du bonheur. En tant qu’il est conçu dans le temps, le bonheur est changement, et l’on nous dit heureux ou malheureux suivant que nous changeons en mieux ou en pire… Cela suppose naturellement une comparaison entre deux moments successifs et, qui sont par là, l’espérance (Là on cherche le bonheur et donc on est heureux) et la crainte (Là on fuit un malheur et donc on est malheureux)… Être heureux, dans le temps, c’est toujours espérer l’être ou craindre de ne l’être plus, et c’est pourquoi le bonheur n’est jamais parfait, on espère toujours l’augmenter, on craint toujours de le perdre... c’est pourquoi, même, il n’est jamais là: le temps qui le contient nous en sépare, l’imagination qui le vise nous en prive… Tout bonheur, en ce sens, est imaginaire, c’est l’imagination de la joie possible, et il est réel seulement en tant qu’imaginaire… La béatitude, au contraire, serait un bonheur vrai, c’est-à-dire éternel. La vérité l’est toujours et se déployant non dans l’imagination du passé ou de l’avenir, mais dans la nécessité du présent… C’est moins un autre bonheur que le bonheur même, vécu et pensé en vérité: non plus l’imagination de la joie possible, mais la connaissance vraie éternelle de la joie réelle. Cette joie réelle, pour Spinoza, ne va pas sans amour… Qu’est-ce en effet qu’aimer' C’est se réjouir, explique Spinoza, à l’idée de quelque chose: L’amour est une joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure... Cette définition, si elle paraît abstraite, rencontre pourtant l’expérience commune: dire à quelqu’un "je suis joyeux à l’idée que tu existes" c'est bien lui déclarer son
amour… Mais, d’ordinaire, nous sommes surtout joyeux (encore n’est-ce vrai, le plus souvent, qu’en imagination) à l’idée de posséder l’autre, auquel cas ce n’est pas lui que nous aimons mais sa possession; ou bien d’en être aimé, auquel cas ce n’est pas lui que nous aimons mais son amour… Et c’est ce qu’on appelle la possession, toujours égoïste, toujours narcissique, et promise à l’échec seulement: on ne peut posséder personne, ni être aimé jamais comme on le voudrait, et c’est la seule déception peut-être à laquelle on ne s’habitue pas… L’amour, au contraire, le véritable amour, celui qui est amour non de soi, mais de l’autre, est généreux toujours: il ne manque de rien, il est désir non de ce qui n’est pas, mais de ce qui est, il ne demande rien puisque rien ne lui manque, il n’espère rien... Ce n’est pas l’éros de Platon (Heros) mais la philia (Foi) d’Aristote ou d’Épicure, l’agapè de Jésus ou des prophètes; bref cet amour que les scolastiques appelaient non de concupiscence, mais d’amitié, et c’est bien le nom en effet qui lui convient… L’amant veut posséder l’aimé, et souffre de ne le pouvoir, puis s’ennuie de l’avoir pu... L’ami véritable se réjouit au contraire non de posséder ses amis (il sait bien que c’est impossible, que l’amitié n’illumine jamais que la solitude), pas même d’en être aimé, puisque voilà longtemps qu’il n’y tient plus, qu’il est libéré de ce petit commerce des sentiments… Il se réjouit du fait que les amis soient… Sa joie n’est pas une caractéristique de son amitié, mais sa définition même... Il n’y a pas d’amour éros heureux; il n’y a pas d’amitié philia, agapè malheureuse… Cela, qui redonne une chance au couple peut-être, donne aussi la formule de la sagesse: le sage est l’ami du monde, de ses amis et de soi-même. Que cela soit également, et par là même, la formule du bonheur, c’est ce que chacun a compris et, de loin en loin, expérimente… Sans l’amitié, dit à peu près Aristote, la vie serait une erreur, et c’est en quoi, ajoute Épicure, "de tous les biens que la sagesse nous procure, l’amitié est de beaucoup le plus grand"… ce qui signifie que la sagesse ne serait rien sans le bonheur, ni le bonheur sans l’amitié ... C’est
aussi ce que Spinoza, bien plus tard et avec d’autres mots, confirmera: "il n’est bonheur que de joie; il n’est joie que d’aimer."
Ayant bien montré la différence entre l'ami l'amant et l'amoureux - dont comme je vous en ai expliqué, il en existe une très large différence que j'exploiterais à l'instant - Une question trouve sa place ici: est ce cela l'unique espérance d'être aimé et d’aimer.. Être un ami, l'amitié' Sinon pourquoi ne pas exploiter l'amour dans son essence, convenablement comme l'amitié dans ses enjeux de stabilisation de nos états d'âme... Si l'amitié s'en est trouvé presque comme le meilleurs moyen du bonheur, sans pour autant satisfaire notre joie d'être aimé et d'aimer au sens propre.. Est ce chercher dans les sens de l'amour la voie qui nous permettrais vraiment de satisfaire nos désirs, à voir, être aimé et aimer l'autre ' Tout ces nom historiques et si significatifs attribuées aux engrais de l'histoire humaine valent nécessairement une utilité… Partant du terme latin concupiscere, désirer ardemment, on trouve aussi pour même origine :cupere, désirer, convoiter, d’où est tiré le nom romain du dieu de l’Amour, Cupidon, identifié à l’Éros des Grecs... Dans la langue courante moderne, concupiscence désigne le penchant à jouir des biens sensibles, voire l’attachement aux plaisirs sensuels et corporelles. Dans la langue philosophique et théologique, on trouve l’amour de concupiscence, l’amour de complaisance et l’amour de bienveillance… L’amour de concupiscence tend à la satisfaction des désirs éprouvés par le sujet qui aime, c’est un amour égocentrique, intéressé… L'amour de complaisance trouve son plaisir dans le bonheur que ressent l’être aimé, c’est un amour allocentrique, désintéressé… L’amour de bienveillance recherche le bien de la personne aimée, c’est un amour altruiste, une générosité en quête de ce qui est bon pour autrui…. Ces distinctions, établies au Moyen Âge, sont toujours en vigueur à la période classique et moderne, citons comme exemples: François de Sales, Descartes, Malebranche, Bossuet... La scolastique médiévale ne les a pas forgées de toutes
pièces... elle fait user du terme "Volente" mais pas de l'amour : La volonté de bien, la bienveillance, la volonté qui prend plaisir au contentement d’autrui, la complaisance… La volonté qui est un élan de nature, une tendance à la fois rationnelle et vitale, mais nécessaire, donc distincte du choix réfléchi, de la volition libre et raisonnée, ou encore le vouloir comme tendance fondamentale, comme désir naturel, la concupiscence, comme puissance de conservation de soi, de persévérance dans l’être, de développement et d’épanouissement… d’où l’empressement des Pères grecs à relire Platon, qui use du même vocable dans sa théorie du désir ... Le latin de la Vulgate traduit par concupiscentia, concupiscence… Comme ce terme, dans le passage cité, paraît désigner soit la convoitise de sexualité, soit la convoitise de curiosité, il n’a pas tardé à être pris systématiquement en mauvaise part, surtout pour la concupiscence de la chair: cette expression a fondé toute une tradition de rigueur puritaine dont s'est fondée à part de lion la philosophie moderne surtout anglaise et française, qui ont fait de cela la clef de la révolution française qui tient la tête du changement des temps moderne... En fait, à l'origine de cette perturbation philosophique par les plaisirs et l'attraction matérialiste, le point fort de ces dernières philosophies résidait dans l’opposition de l’amour de Dieu et de l’amour du monde (ou des objets du monde): par quoi il faut entendre, en conformité avec le message des prophètes, que le salut vient de Dieu seul, de ses initiatives, de ses dons, et que toute tentative d’y accéder par un mouvement de la nature humaine (captation envieuse, jouisseuse ou orgueilleuse) est vouée à l’échec... Nous en sommes si peu capables, nous en avons, même, si peu d’expérience, nous sommes si mal aimants et si mal aimés!' Qu’on ose à peine l’écrire...
Mais faut-il pour autant oublier de continuer sur les chemins des leçons des maîtres' Ce qu’ils enseignent, et presque en tout temps, et presque en tout pays, c’est que la conversion du désir, à quoi se ramène la sagesse, est
conversion de l’amour, et à l’amour... Mais lequel' Être amoureux est un état, disait Denis de Rougemont, aimer, un acte ; et les actes seuls dépendent de nous... Sans forcément refuser la passion, comment le pourrait-on, quand elle est là' C'est donc sur cet acte d’aimer, non l’amour-passion mais l’amour-action! Qu’il faut faire fond…
Il n’y a pas d’amour éros heureux, et c’est notre part de folie; il n’y a pas de bonheur sans amour philia, agapè, et c’est notre part de sagesse… Cela donne, sinon la recette du bonheur, il est clair qu’il n’y en a pas, qu’il ne peut y en avoir, du moins l’indication d’un chemin, bien simple, comme il convient, et bien difficile: il s’agit d’espérer un peu moins, fût-ce le bonheur, et d’aimer un peu plus… Amour de prise, un amour captatif, intéressé: l'Agapè qui convient principalement à l’amour fraternel, à l’amour paisible et pur, à l’amour de dilection… Pas un amour de prévenance, de courtoisie, un amour oblatif et désintéressé, qui tend à traîner et étouffer. Ces formules nourris d’imagination, sans doute se montrent-t-ils aussi tyranniques qu’insatiables, dans leurs bases mystérieuses, par excellence, qui se référencient aux amours enfantines; si difficiles pour nous les adultes… Ces adultes si sophistiqués à point où; la sensibilité, l'émotivité, la sensitivité et le coeur mystérieusement se déconnectent. Tandis que la mélancolie écrase tout sujet devenu impuissant à ressentir l’aiguillon qui l’anime… Le problème du bonheur est que la valeur que nous lui attachons est liée à son mystère même. Aussi cette valeur apparaît-elle suspecte à beaucoup, qui préfèrent ne voir dans ses raisons du cœur que des connaissances confuses, des résidus irrationnels de l’enfance dans la vie adulte. Mais ce mépris du sentiment ne revient-il pas à mutiler l’homme d’une part essentielle de lui-même' le plus intellectualiste des philosophes doit bien admettre qu’il existe des expériences comme la joie, l’admiration, l’amitié, l’amour, dont rien ne pourrait vraiment combler le vide laissé par leur absence. Inexplicables, car on ne peut
pas analyser un sentiment, le ramener à des causes ou à des facteurs objectifs sans perdre aussitôt ce qui en fait l’essence: expliquer à une mère pourquoi elle aime son enfant, n’est-ce pas réduire cet amour à autre chose et finalement le nier'
Le bonheur suppose en cela, répétons-le, quelque chose comme le dédain du bonheur, et nous retrouvons là notre question initiale… À quoi bon être heureux' Question saugrenue, disions-nous, et bien entendu sans réponse… Cela ne signifie pas qu’elle soit sans objet… Il se pourrait, au contraire, que le bonheur ne soit possible que dans cette indifférence vis-à-vis de lui - qu’on l’appelle désespoir ou générosité - où, sans plus d’amertume ni de regret et cessant même d’être espéré, il apparaît comme quantité finalement négligeable: moins nécessaire que la vérité, moins utile que le courage… S’il est vrai que l’homme se distinguera toujours du plus parfait des ordinateurs, ce n’est pas par le fait de raisonner, mais de sentir. Sans le sentiment, aucune question ne serait posée, aucun mobile ne serait donné pour apprécier, pour préférer, pour agir. "La raison n’a jamais que de la lumière; il faut que l’impulsion lui vienne d’ailleurs", disait Albert Einstein. Mais il ajoutait, ce qui marque à la fois la valeur et la limite du sentiment: "Si le cœur doit toujours poser les questions, c’est toujours à l’esprit qu’il appartient de les résoudre." et c'est ce que j'essayerais d'approfondir l'année prochaine dans ma deuxième édition de mon futur livre "les alentours du bonheur".
À quoi bon être heureux' Il n’y a peeuuuuut-être pas de réponse, et c’est le bonheur même… Il n’est donné que par surcroît et modestie...